Pression de Radiation d’un Gaz de Photons
Contexte : Le Gaz de PhotonsModèle thermodynamique du rayonnement électromagnétique (lumière) traité comme un gaz de particules (photons)..
En thermodynamique statistique, le rayonnement électromagnétique à l'équilibre thermique dans une cavité (connu sous le nom de "rayonnement de corps noir") peut être traité comme un gaz de particules appelées photons. Les photons sont des bosonsType de particule qui obéit à la statistique de Bose-Einstein (ex: photons, gluons, boson de Higgs). de masse nulle et de spin 1. Une caractéristique clé est que leur nombre n'est pas conservé, ce qui implique que leur potentiel chimiqueParamètre thermodynamique lié à la variation d'énergie lors de l'ajout d'une particule. Nul pour les photons. est nul (\(\mu = 0\)).
Comprendre les propriétés de ce gaz, notamment son énergie interne et la pression qu'il exerce (la pression de radiation), est fondamental en astrophysique (pour décrire l'équilibre des étoiles) et en cosmologie (pour comprendre l'évolution de l'univers primitif).
Remarque Pédagogique : Cet exercice vous guidera à travers les étapes de la physique statistique pour dériver l'une des relations les plus importantes du rayonnement de corps noir : l'équation d'état \(\left(P = \frac{1}{3}u\right)\), qui lie la pression \(\left(P\right)\) à la densité d'énergie interne \(\left(u = U/V\right)\).
Objectifs Pédagogiques
- Comprendre le modèle statistique du gaz de photons (bosons avec \(\mu=0\)).
- Savoir calculer la densité d'étatsNombre d'états d'énergie disponibles par intervalle d'énergie. \(\left(g(\epsilon)\right)\) pour des particules relativistes sans masse.
- Dériver l'expression de l'énergie interne \(\left(U\right)\) (Loi de Stefan-Boltzmann).
- Utiliser la grande fonction de partition \(\left(\mathcal{Z}\right)\) pour calculer la pression \(\left(P\right)\).
- Démontrer l'équation d'état \(\left(P = \frac{1}{3} \frac{U}{V}\right)\).
Données de l'étude
Fiche Technique
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Type de particules | Photons (Bosons de masse nulle) |
| Potentiel chimique \(\left(\mu\right)\) | \(\mu = 0\) (nombre de particules non conservé) |
| Relation de dispersion | \(\epsilon(p) = pc\) (où \(\left(p\right)\) est la quantité de mouvement et \(\left(c\right)\) la vitesse de la lumière) |
| Polarisations | 2 (deux états de polarisation hélicité \(\pm 1\)) |
Cavité de Corps Noir
| Nom du Paramètre | Description ou Formule | Symbole | Unité (SI) |
|---|---|---|---|
| Constante de Planck | Quantum d'action | \(\left(h \approx 6.626 \times 10^{-34}\right)\) | J·s |
| Constante de Boltzmann | Lien entre température et énergie | \(\left(k_B \approx 1.381 \times 10^{-23}\right)\) | J/K |
| Vitesse de la lumière | Vitesse des photons dans le vide | \(\left(c \approx 3.00 \times 10^8\right)\) | m/s |
Questions à traiter
- Calculer la densité d'états \(\left(g(\epsilon)d\epsilon\right)\), c'est-à-dire le nombre d'états de photons ayant une énergie comprise entre \(\epsilon\) et \(\epsilon+d\epsilon\). (N'oubliez pas les 2 états de polarisation).
- Écrire l'expression de l'énergie interne totale \(\left(U\right)\) du gaz de photons en fonction de \(\left(T\right)\) et \(\left(V\right)\) sous forme d'une intégrale. Montrer que \(\left(U\right)\) est de la forme \(\left(U = a V T^4\right)\) (Loi de Stefan-Boltzmann).
- Exprimer le logarithme de la grande fonction de partition \(\left(\ln(\mathcal{Z})\right)\) sous forme d'une intégrale en fonction de la densité d'états \(\left(g(\epsilon)\right)\).
- En utilisant la relation thermodynamique \(\left(P V = k_B T \ln(\mathcal{Z})\right)\), trouver une expression intégrale pour la pression \(\left(P\right)\).
- En comparant les expressions intégrales de \(\left(U\right)\) (de la Q2) et \(\left(P\right)\) (de la Q4), démontrer la relation \(\left(P = \frac{1}{3} \frac{U}{V}\right)\).
Les bases sur la Statistique des Photons
Pour résoudre cet exercice, nous avons besoin de quelques outils de la thermodynamique statistique appliqués aux bosons.
1. Statistique de Bose-Einstein (\(\mu=0\))
Les photons sont des bosons indiscernables dont le nombre n'est pas fixé. Leur potentiel chimique est donc nul (\(\mu=0\)). Le nombre moyen d'occupation d'un état d'énergie \(\epsilon\) est donné par la distribution de Bose-Einstein :
\[ \langle n(\epsilon) \rangle = \frac{1}{e^{\epsilon/k_B T} - 1} \]
2. Densité d'États (Cas relativiste)
Pour des particules dans une boîte 3D de volume \(\left(V\right)\) avec une quantité de mouvement \(\left(p\right)\), le nombre d'états est \(\left(dN = g(p) dp\right)\). En incluant les 2 polarisations :
\[ dN = 2 \times \frac{V 4\pi p^2 dp}{h^3} \]
En utilisant la relation de dispersion \(\epsilon = pc\), on peut trouver la densité d'états en énergie \(\left(g(\epsilon)d\epsilon\right)\).
3. Grande Fonction de Partition (\(\mathcal{Z}\))
Pour des bosons, le logarithme de la grande fonction de partition est :
\[ \ln(\mathcal{Z}) = -\sum_s \ln(1 - e^{-(\epsilon_s - \mu)/k_B T}) \]
Pour les photons (\(\mu=0\)) et en passant à une distribution continue d'états :
\[ \ln(\mathcal{Z}) = -\int_0^\infty g(\epsilon) \ln(1 - e^{-\epsilon/k_B T}) d\epsilon \]
4. Liens Thermodynamiques
L'énergie interne \(\left(U\right)\) et la Pression \(\left(P\right)\) sont liées à \(\mathcal{Z}\) :
\[ U = \int_0^\infty \epsilon \langle n(\epsilon) \rangle g(\epsilon) d\epsilon \]
\[ P V = k_B T \ln(\mathcal{Z}) \]
Correction : Pression de Radiation d’un Gaz de Photons
Question 1 : Calculer la densité d'états \(\left(g(\epsilon)d\epsilon\right)\)
Principe
L'objectif est de "compter" combien d'états quantiques (modes vibratoires du champ électromagnétique) existent dans un intervalle d'énergie \(\left[ \epsilon, \epsilon+d\epsilon \right]\). On commence par compter dans l'"espace des quantités de mouvement" (espace-p), puis on utilise la relation \(\epsilon = pc\) pour convertir ce comptage en "espace des énergies".
Mini-Cours
Pour des particules confinées dans une boîte de volume \(\left(V\right)\), le nombre d'états dans un volume \(\left(d^3p\right)\) de l'espace des quantités de mouvement est \(\left(V d^3p / h^3\right)\). Pour des particules comme les photons, qui ont deux polarisations (deux états internes indépendants), on multiplie par 2. On s'intéresse aux états dans une coquille sphérique de rayon \(\left(p\right)\) et d'épaisseur \(\left(dp\right)\), dont le volume est \(\left(d^3p = 4\pi p^2 dp\right)\).
Remarque Pédagogique
Le passage de l'espace-p à l'espace-e est une simple "traduction". Si \(\left(dN\right)\) états existent entre \(\left(p\right)\) et \(\left(p+dp\right)\), alors ces \(\left(dN\right)\) mêmes états doivent exister entre l'énergie \(\left(\epsilon\right)\) et \(\left(\epsilon+d\epsilon\right)\) correspondante. On a donc \(\left(dN = g(p)dp = g(\epsilon)d\epsilon\right)\). Le but est de trouver \(\left(g(\epsilon)\right)\).
Normes
Ce calcul n'est pas une "norme" au sens de l'ingénierie, mais un "Principe Fondamental" de la mécanique statistique pour un gaz libre dans le "continuum" (lorsque la taille de la boîte \(\left(V\right)\) est très grande par rapport à la longueur d'onde).
Formule(s)
Nombre d'états (espace-p)
Relation de dispersion
Hypothèses
On suppose que le volume \(\left(V\right)\) est suffisamment grand pour que les niveaux d'énergie soient si rapprochés qu'on puisse les traiter comme un continuum, permettant de remplacer la somme discrète sur les états par une intégrale sur la densité d'états.
Donnée(s)
Nous utilisons les données de l'énoncé :
- Facteur 2 pour les polarisations.
- Relation \(\epsilon = pc\).
- Volume de la boîte \(\left(V\right)\).
- Constante de Planck \(\left(h\right)\).
Astuces
Pensez à \(\left(h^3\right)\) comme le "volume" d'une cellule dans l'espace des phases \(\left(d^3r d^3p\right)\). Le nombre total d'états est le volume total de l'espace des phases divisé par le volume d'une cellule : \(\left(\int d^3r d^3p\right) / h^3 = (V \cdot 4\pi p^2 dp) / h^3\). N'oubliez pas le facteur 2 pour le spin/polarisation !
Schéma (Avant les calculs)
Espace des quantités de mouvement
Calcul(s)
On part de l'égalité \(\left(dN = g(p)dp = g(\epsilon)d\epsilon\right)\). On connaît \(\left(g(p)\right)\) et on a les relations de "traduction" \(\left(p = \epsilon/c\right)\) et \(\left(dp = d\epsilon/c\right)\). On substitue ces relations dans \(\left(g(p)dp\right)\) pour trouver \(\left(g(\epsilon)d\epsilon\right)\).
En identifiant les termes de part et d'autre de l'égalité \(\left(g(\epsilon)d\epsilon = [ ... ] d\epsilon\right)\), on trouve :
Schéma (Après les calculs)
Densité d'états g(ε)
Réflexions
Le résultat \(\left(g(\epsilon) \propto \epsilon^2\right)\) est crucial. Il signifie que le nombre d'états disponibles pour les photons augmente très rapidement avec l'énergie (quadratiquement). C'est cette croissance rapide qui, combinée à la décroissance exponentielle de la statistique de Bose-Einstein (\(\langle n \rangle\)), donne la forme de la courbe du corps noir.
Points de vigilance
Ne pas oublier le facteur 2 pour les deux états de polarisation indépendants. C'est une erreur fréquente qui conduit à un résultat final erroné d'un facteur 1/2. De plus, bien distinguer \(\left(h\right)\) (constante de Planck) de \(\left(\hbar = h/2\pi\right)\). Si on utilise \(\left(\hbar\right)\), la densité d'états s'écrit \(\left(g(p)dp = 2 \cdot V 4\pi p^2 dp / (2\pi\hbar)^3 = V p^2 dp / (\pi^2 \hbar^3)\right)\).
Points à retenir
- La densité d'états pour des particules sans masse (comme les photons) en 3D est proportionnelle à \(\left(V \epsilon^2\right)\).
- Ce résultat vient de \(\left(p^2 dp\right)\) dans l'espace-p et de la relation \(\epsilon = pc\).
Le saviez-vous ?
Cette même dérivation \(\left(g(\epsilon) \propto \epsilon^2\right)\) s'applique aussi aux "phonons" (quanta de vibration) dans un solide pour le modèle de Debye, car eux aussi ont une relation de dispersion linéaire \(\left(\epsilon \approx v_s p\right)\) à basse énergie, où \(\left(v_s\right)\) est la vitesse du son. C'est ce qui explique la loi en \(\left(T^3\right)\) de la capacité calorifique des solides à basse température.
FAQ
Résultat Final
A vous de jouer
Si les photons étaient confinés à un "carré" 2D de surface \(\left(A\right)\), la densité d'états serait \(\left(g(\epsilon) \propto \epsilon^k\right)\). Que vaut \(\left(k\right)\) ? (Indice : en 2D, \(\left(dN \propto p dp\right)\)).
Mini Fiche Mémo
Synthèse de la Question 1 :
- Concept Clé : Densité d'états \(\left(g(\epsilon)\right)\).
- Formule : \(g(p)dp \propto V p^2 dp \implies g(\epsilon)d\epsilon \propto V \epsilon^2 d\epsilon\) (pour \(\epsilon=pc\)).
- Point de Vigilance : Ne pas oublier le facteur 2 (polarisations).
Question 2 : Énergie interne \(\left(U\right)\) (Loi de Stefan-Boltzmann)
Principe
L'énergie interne totale \(\left(U\right)\) du gaz est la somme de l'énergie de tous les photons présents. Pour l'obtenir, on intègre sur toutes les énergies possibles : [l'énergie d'un état \(\left(\epsilon\right)\)] \(\times\) [le nombre moyen de photons dans cet état \(\left(\langle n(\epsilon) \rangle\right)\)] \(\times\) [le nombre d'états ayant cette énergie \(\left(g(\epsilon)d\epsilon\right)\)].
Mini-Cours
Le nombre moyen d'occupation \(\left(\langle n(\epsilon) \rangle\right)\) pour des bosons (photons) à potentiel chimique nul (\(\mu=0\)) est donné par la distribution de Bose-EinsteinFormule statistique donnant le nombre moyen de particules (bosons) dans un état d'énergie donné. : \(\langle n(\epsilon) \rangle = \frac{1}{e^{\epsilon/k_B T} - 1}\). C'est le "thermomètre" du système, il dicte comment les photons se répartissent en énergie à une température \(\left(T\right)\) donnée.
Remarque Pédagogique
L'intégrale qui apparaît, \(\left( \int \frac{\epsilon^3}{e^{\epsilon/k_B T} - 1} d\epsilon \right)\), est un classique de la physique statistique. Pour la résoudre, le réflexe doit être immédiat : poser le changement de variable \(\left(x = \epsilon / k_B T\right)\). Cela rend l'intégrale sans dimension et fait apparaître toute la dépendance en température \(\left(T^4\right)\) à l'extérieur de l'intégrale.
Normes
Le résultat de ce calcul est la Loi de Stefan-BoltzmannLoi stipulant que la densité d'énergie totale d'un corps noir est proportionnelle à T⁴., qui stipule que la densité d'énergie interne \(\left(u = U/V\right)\) est proportionnelle à \(\left(T^4\right)\). C'est une loi fondamentale du rayonnement thermique.
Formule(s)
Formule de l'énergie interne
Intégrale de Bose-Einstein (valeur donnée)
Hypothèses
On suppose que le gaz de photons est à l'équilibre thermique à une température \(\left(T\right)\) bien définie. On suppose aussi que c'est un gaz parfait : les photons n'interagissent pas entre eux (ils n'interagissent que faiblement avec les parois de la boîte pour atteindre l'équilibre).
Donnée(s)
Nous utilisons le résultat de la Q1 :
- \(g(\epsilon) = \frac{8\pi V}{h^3 c^3} \epsilon^2\)
- \(\langle n(\epsilon) \rangle = (e^{\epsilon/k_B T} - 1)^{-1}\)
Astuces
Lors du changement de variable \(\left(x = \epsilon/k_B T\right)\), n'oubliez pas de transformer tous les termes : \(\left(\epsilon = x k_B T\right)\) et \(\left(d\epsilon = k_B T dx\right)\). Vous aurez donc \(\left(\epsilon^3 d\epsilon = (x k_B T)^3 (k_B T dx) = (k_B T)^4 x^3 dx\right)\). C'est ce \(\left((k_B T)^4\right)\) qui donne la loi en \(\left(T^4\right)\).
Schéma (Avant les calculs)
Spectre du Corps Noir (Loi de Planck)
L'intégrale de U correspond à l'aire sous la courbe de la densité d'énergie spectrale (loi de Planck), qui est ε · <n> · g(ε).
Calcul(s)
Étape 1 : Poser l'intégrale
On substitue \(\langle n(\epsilon) \rangle\) et \(g(\epsilon)\) dans la formule de \(U\).
Étape 2 : Changement de variable
Posons \(\left(x = \frac{\epsilon}{k_B T}\right)\). Cela implique :
On substitue ces trois termes dans l'intégrale :Étape 3 : Résolution
L'intégrale est une constante \(\left(I = \int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1} dx = \frac{\pi^4}{15}\right)\). On la substitue :
On pose \(\left(a = \frac{8\pi^5 k_B^4}{15 h^3 c^3}\right)\), qui est la constante de rayonnement de Stefan-Boltzmann.
Schéma (Après les calculs)
Énergie interne vs Température
Réflexions
L'énergie interne \(\left(U\right)\) est extensive (proportionnelle à \(\left(V\right)\)) et croît très rapidement avec la température (comme \(\left(T^4\right)\)). Cela signifie que si vous doublez la température d'une cavité, vous multipliez par 16 l'énergie du rayonnement qu'elle contient. C'est pourquoi le rayonnement devient la forme dominante d'énergie à très haute température (dans les étoiles, l'univers primitif).
Points de vigilance
La principale difficulté est le changement de variable. Assurez-vous de transformer \(\left(\epsilon^3\right)\) ET \(\left(d\epsilon\right)\), ce qui donne bien un facteur \(\left((k_B T)^4\right)\) et non \(\left((k_B T)^3\right)\).
Points à retenir
- L'énergie interne \(\left(U\right)\) d'un gaz de photons est donnée par la Loi de Stefan-Boltzmann : \(U = a V T^4\).
- La densité d'énergie \(\left(u = U/V\right)\) ne dépend que de \(\left(T\right)\).
Le saviez-vous ?
La loi de Stefan-Boltzmann a été découverte expérimentalement par Jožef Stefan en 1879 en mesurant le rayonnement d'un filament de platine. Elle a été dérivée théoriquement par Ludwig Boltzmann en 1884 en utilisant la thermodynamique classique. La dérivation statistique, comme celle-ci, est venue plus tard avec Planck et Bose.
FAQ
Résultat Final
A vous de jouer
Connaissant \(\left(U = a V T^4\right)\), calculez la capacité calorifique à volume constant \(\left(C_V = (\partial U / \partial T)_V\right)\). Que vaut le coefficient \(\left(k\right)\) dans l'expression \(\left(C_V = k \cdot a V T^3\right)\) ?
Mini Fiche Mémo
Synthèse de la Question 2 :
- Concept Clé : Loi de Stefan-Boltzmann.
- Formule : \(U = \int \epsilon \cdot \langle n(\epsilon) \rangle \cdot g(\epsilon) d\epsilon\).
- Résultat : \(U = a V T^4\).
Question 3 : Logarithme de la grande fonction de partition \(\left(\ln(\mathcal{Z})\right)\)
Principe
La grande fonction de partition \(\left(\mathcal{Z}\right)\) est l'outil fondamental de l'ensemble grand-canonique. Elle contient toute l'information thermodynamique du système. Le grand potentiel \(\left(\Omega\right)\) est \(\left(\Omega = -PV = -k_B T \ln(\mathcal{Z})\right)\). Pour des bosons, \(\left(\ln(\mathcal{Z})\right)\) est une somme sur tous les états \(\left(s\right)\) de \(\left(-\ln(1 - e^{-(\epsilon_s - \mu)/k_B T})\right)\).
Mini-Cours
Pour un seul état quantique \(\left(s\right)\) pouvant être occupé par \(\left(n\right)\) bosons, la fonction de partition est \(\left(Z_s = \sum_{n=0}^\infty e^{-n(\epsilon_s - \mu)/k_B T}\right)\). C'est une série géométrique qui vaut \(\left(Z_s = \frac{1}{1 - e^{-(\epsilon_s - \mu)/k_B T}}\right)\).
La fonction de partition totale \(\left(\mathcal{Z}\right)\) est le produit des \(\left(Z_s\right)\) pour tous les états (car ils sont indépendants). Donc \(\left(\ln(\mathcal{Z}) = \sum_s \ln(Z_s) = -\sum_s \ln(1 - e^{-(\epsilon_s - \mu)/k_B T})\right)\).
Remarque Pédagogique
Comme pour l'énergie interne, on passe de la somme discrète \(\left(\sum_s\right)\) à une intégrale continue \(\left(\int d\epsilon \, g(\epsilon)\right)\). C'est la procédure standard lorsque les niveaux d'énergie sont très rapprochés (grand volume \(\left(V\right)\)).
Normes
Ceci est la formulation standard de la grande fonction de partition pour un gaz de bosons libres dans l'ensemble grand-canonique.
Formule(s)
Conversion Somme -> Intégrale
\(\ln(\mathcal{Z})\) pour bosons (avec \(\mu=0\))
Hypothèses
On utilise les mêmes hypothèses qu'auparavant : gaz de bosons (photons) indépendants, à l'équilibre thermique \(\left(T\right)\), avec un potentiel chimique nul (\(\mu=0\)).
Donnée(s)
On utilise le résultat de la Q1 :
- \(g(\epsilon) = \frac{8\pi V}{h^3 c^3} \epsilon^2\)
Calcul(s)
On part de la formule intégrale pour \(\left(\ln(\mathcal{Z})\right)\) et on y insère l'expression de \(\left(g(\epsilon)\right)\) trouvée à la Q1.
On a sorti les constantes \(\left( \frac{-8\pi V}{h^3 c^3} \right)\) de l'intégrale. On voit que \(\left(\ln(\mathcal{Z})\right)\) est proportionnel à \(\left(V\right)\), ce qui est normal car \(\left(PV\right)\) est une grandeur extensive.
Réflexions
Cette expression n'est pas très parlante en soi, mais elle est la "mère" de toutes les autres grandeurs thermodynamiques. En la dérivant par rapport à \(\left(T\right)\), on peut retrouver \(\left(U\right)\) et \(\left(S\right)\) (l'entropie). En l'utilisant directement, on trouve la pression \(\left(P\right)\), comme demandé en Q4.
Points de vigilance
Le signe "moins" est crucial. Il vient de \(\left(\ln(1/X) = -\ln(X)\right)\). Ne l'oubliez pas.
Points à retenir
- Le grand potentiel \(\left(\Omega = -PV\right)\) est \(\left(-k_B T \ln(\mathcal{Z})\right)\).
- Pour les bosons, \(\left(\ln(\mathcal{Z})\right)\) est une intégrale de \(\left(g(\epsilon) \ln(1 - ...)\right)\) avec un signe "moins".
Résultat Final
A vous de jouer
De l'expression ci-dessus, on peut montrer que \(\left(\ln(\mathcal{Z}) = C V T^3\right)\), où \(\left(C\right)\) est un groupe de constantes. En utilisant \(\left(P V = k_B T \ln(\mathcal{Z})\right)\), que vaut le rapport \(\left(P / (C k_B T^4)\right)\) ?
Mini Fiche Mémo
Synthèse de la Question 3 :
- Concept Clé : Grande fonction de partition \(\left(\mathcal{Z}\right)\).
- Formule : \(\ln(\mathcal{Z}) = -\int g(\epsilon) \ln(1 - e^{-\epsilon/k_B T}) d\epsilon\).
- Propriété : \(\ln(\mathcal{Z}) \propto V\).
Question 4 : Trouver l'expression de la pression \(\left(P\right)\)
Principe
On utilise la relation thermodynamique fondamentale \(\left(PV = k_B T \ln(\mathcal{Z})\right)\). Puisque l'expression de \(\left(\ln(\mathcal{Z})\right)\) (trouvée en Q3) est proportionnelle à \(\left(V\right)\), on peut simplifier \(\left(V\right)\) de chaque côté pour isoler \(\left(P\right)\). L'intégrale restante doit être simplifiée.
Mini-Cours
La technique clé ici est l'intégration par parties (IPP) : \(\left(\int u \, dv = [uv] - \int v \, du\right)\). On l'utilise pour transformer l'intégrale de \(\left(\epsilon^2 \ln(1 - e^{-\epsilon/k_B T})\right)\) en une intégrale de \(\left(\epsilon^3 / (e^{\epsilon/k_B T} - 1)\right)\), qui est la forme que nous connaissons de la Q2.
Remarque Pédagogique
Cette IPP est une astuce mathématique qui a une signification physique profonde. Elle relie la pression (liée au \(\left(\ln(\mathcal{Z})\right)\)) à l'énergie interne. C'est le cœur de la dérivation de l'équation d'état.
Formule(s)
Relation Pression-Partition
Intégration Par Parties (IPP)
Hypothèses
Le système est à l'équilibre thermodynamique, permettant l'utilisation des relations grand-canoniques.
Donnée(s)
On utilise l'expression de \(\left(\ln(\mathcal{Z})\right)\) de la Q3.
Calcul(s)
Étape 1 : Substitution
On part de \(\left(P V = k_B T \ln(\mathcal{Z})\right)\) et on insère \(\left(\ln(\mathcal{Z})\right)\) de la Q3.
On peut simplifier \(\left(V\right)\) de chaque côté.
Étape 2 : Intégration par parties (IPP)
Toutes les étapes suivantes de l'IPP sont regroupées dans un seul bloc de calcul pour plus de clarté.
On se concentre sur l'intégrale
On dérive u et on intègre \(dv\) :
On applique la formule \(\int u \, dv = [uv] - \int v \, du\) :
Le terme nul est 0, on sort les constantes de l'intégrale restante :
Étape 3 : Substitution de \(\left(I\right)\) dans \(\left(P\right)\)
On réinsère ce résultat pour \(\left(I\right)\) dans l'expression de \(\left(P\right)\) de l'Étape 1.
On voit que les termes \(\left(-k_B T\right)\) et \(\left(-1 / (3 k_B T)\right)\) se simplifient pour ne laisser que \(\left(1/3\right)\).
Réflexions
Nous avons transformé une expression compliquée pour \(\left(\ln(\mathcal{Z})\right)\) en une expression pour \(\left(P\right)\) qui contient exactement la même intégrale que celle pour l'énergie interne \(\left(U\right)\). Cela suggère un lien très simple entre \(\left(P\right)\) et \(\left(U\right)\).
Points de vigilance
L'IPP est le point difficile. La dérivée de \(\left(u = \ln(1 - e^{-f(x)})\right)\) est \(\left(u' = \frac{1}{1 - e^{-f}} \cdot (-e^{-f}) \cdot (-f') = \frac{f' e^{-f}}{1 - e^{-f}} = \frac{f'}{e^f - 1}\right)\). Ici \(\left(f(\epsilon) = \epsilon/k_B T\right)\), donc \(\left(f' = 1/k_B T\right)\).
Points à retenir
- La pression se calcule via \(P V = k_B T \ln(\mathcal{Z})\).
- Une IPP permet de transformer l'intégrale de \(\ln(\mathcal{Z})\) en l'intégrale de \(U\).
Résultat Final
A vous de jouer
Utilisez le résultat \(\left(P = \frac{1}{3} a T^4\right)\) pour estimer la pression de radiation à la surface du Soleil (\(\left(T \approx 5778 \, \text{K}\right)\)). Utilisez \(\left(a \approx 7.56 \times 10^{-16} \, \text{J}\cdot\text{m}^{-3}\cdot\text{K}^{-4}\right)\). Donnez la réponse en Pascals (Pa).
Mini Fiche Mémo
Synthèse de la Question 4 :
- Concept Clé : Calcul de la Pression via \(\mathcal{Z}\).
- Outil : Intégration par parties (IPP).
- Résultat : \(P = \frac{1}{3} \times (\text{intégrale de } U/V)\).
Question 5 : Démontrer la relation \(\left(P = \frac{1}{3} \frac{U}{V}\right)\)
Principe
Cette étape est une simple "mise en relation". Il suffit de prendre l'expression finale pour \(\left(U\right)\) de la Q2 et l'expression finale pour \(\left(P\right)\) de la Q4, et de les comparer terme à terme.
Mini-Cours
La densité d'énergie interne est définie comme l'énergie par unité de volume : \(\left(u = U/V\right)\). La question demande de prouver que \(\left(P = u/3\right)\). Cette relation est l'équation d'état du gaz de photons. Elle remplace l'équation d'état des gaz parfaits \(\left(PV=NkT\right)\).
Remarque Pédagogique
La beauté de cette dérivation est qu'elle est rigoureuse. On n'a pas eu besoin de connaître la valeur de l'intégrale \(\left(\pi^4/15\right)\). Le simple fait que \(\left(P\right)\) et \(\left(U\right)\) dépendent de la *même* intégrale (à un facteur \(\left(1/3\right)\) et \(\left(V\right)\) près) suffit à prouver la relation.
Formule(s)
Énergie interne (de Q2)
Pression (de Q4)
Calcul(s)
Étape 1 : Rappel des deux résultats
De la Q2, en divisant par V, on a la densité d'énergie \(\left(u = U/V\right)\) :
De la Q4, on a la pression \(\left(P\right)\) :
Étape 2 : Substitution et conclusion
On voit que le terme entier entre crochets \(\left[ ... \right]\) dans l'expression de \(\left(P\right)\) est exactement égal à \(\left(u\right)\).
On peut donc remplacer tout ce terme par \(\left(u\right)\) :
Et comme \(\left(u = U/V\right)\), on a le résultat final :
Schéma (Après les calculs)
Équation d'État
Réflexions
Nous avons démontré l'équation d'état pour un gaz de photons. La pression de radiation est égale à un tiers de sa densité d'énergie. C'est un résultat fondamental en astrophysique, car il détermine l'équilibre des étoiles. Dans une étoile massive, c'est cette pression de radiation qui empêche l'étoile de s'effondrer sous sa propre gravité.
Points de vigilance
Faites attention à ne pas confondre \(\left(u\right)\) (densité d'énergie, \(\left(U/V\right)\)) et \(\left(U\right)\) (énergie totale). La relation est \(\left(P = u/3\right)\), et non \(\left(P = U/3\right)\).
Points à retenir
- L'équation d'état d'un gaz de photons est \(P = u/3\).
- Elle est différente de celle d'un gaz parfait non-relativiste (\(P = (2/3)u\)).
Le saviez-vous ?
Cette relation \(\left(P = u/3\right)\) est caractéristique de tout gaz de particules ultra-relativistes (dont l'énergie \(\epsilon \approx pc\)) en 3D, qu'il s'agisse de bosons (photons) ou de fermions (électrons très haute énergie). C'est cette équation qui régit l'expansion de l'univers lorsque celui-ci était dominé par le rayonnement.
FAQ
Résultat Final
A vous de jouer
Pour un gaz de Fermi (électrons) ultra-relativiste, la relation est aussi \(\left(P = u/3\right)\). Pour un gaz de Fermi non-relativiste à T=0, c'est \(\left(P = 2u/5\right)\). Si un gaz d'électrons est très relativiste, que vaut \(\left(P/u\right)\) (arrondi à 3 décimales) ?
Mini Fiche Mémo
Synthèse de la Question 5 :
- Concept Clé : Équation d'état du gaz de photons.
- Formule : \(U = V \times [\text{intégrale}]\), \(P = \frac{1}{3} \times [\text{intégrale}]\).
- Résultat : \(P = U / (3V) = u/3\).
Outil Interactif : Simulateur (Loi de Stefan-Boltzmann)
Utilisez ce simulateur pour voir comment la température \(\left(T\right)\) et le volume \(\left(V\right)\) influencent la densité d'énergie \(\left(u\right)\), la pression \(\left(P\right)\) et l'énergie totale \(\left(U\right)\) d'un gaz de photons. Le graphique montre la dépendance en \(\left(T^4\right)\) de la densité d'énergie.
Paramètres d'Entrée
Résultats Clés
Quiz Final : Testez vos connaissances
1. Le potentiel chimique \(\left(\mu\right)\) d'un gaz de photons est :
2. La relation de dispersion correcte pour un photon est :
3. L'équation d'état d'un gaz de photons (rayonnement de corps noir) est :
4. La densité d'énergie \(\left(u = U/V\right)\) d'un corps noir varie avec la température \(\left(T\right)\) comme :
5. Les photons obéissent à la statistique de :
Glossaire
- Gaz de photons
- Modèle thermodynamique du rayonnement électromagnétique (comme la lumière) traité comme un gaz de particules (photons).
- Boson
- Type de particule (comme le photon) qui obéit à la statistique de Bose-Einstein et n'est pas soumise au principe d'exclusion de Pauli.
- Potentiel chimique (\(\mu\))
- Paramètre thermodynamique lié à la variation d'énergie lors de l'ajout d'une particule. Pour les photons, il est nul car leur nombre n'est pas conservé.
- Densité d'états (\(g(\epsilon)\))
- Fonction qui décrit le nombre d'états d'énergie disponibles par intervalle d'énergie \(\epsilon\).
- Pression de radiation
- La pression exercée par le rayonnement électromagnétique (photons) sur une surface. C'est ce qui empêche les étoiles massives de s'effondrer sur elles-mêmes.
- Loi de Stefan-Boltzmann
- Loi stipulant que la densité d'énergie totale \(\left(u\right)\) d'un rayonnement de corps noir est proportionnelle à la quatrième puissance de la température (\(u \propto T^4\)).
D’autres exercices de Thermodynamique statistique:
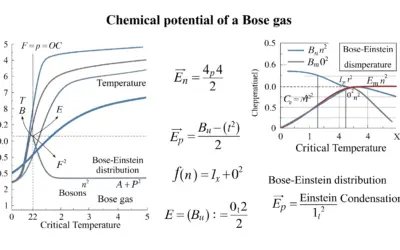
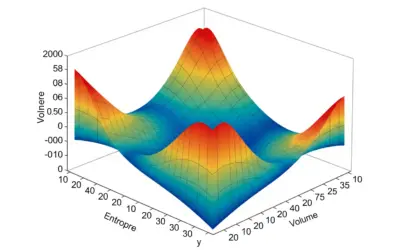

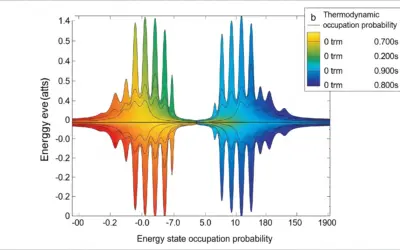
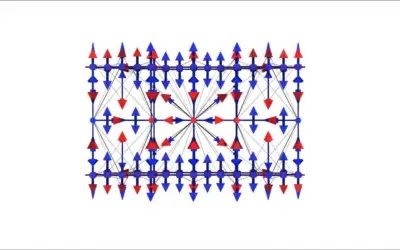
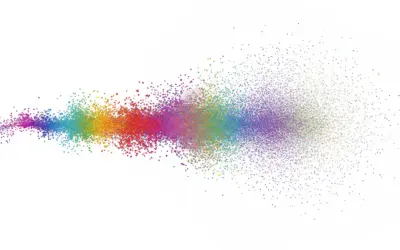
0 commentaires