Détente de Joule-Gay Lussac d'un Gaz Parfait
Contexte : La détente de Joule-Gay LussacExpansion d'un gaz dans le vide, se produisant dans un système thermiquement isolé. C'est un processus fondamental pour étudier les propriétés des gaz..
Cet exercice explore l'une des expériences fondamentales de la thermodynamique classique. On s'intéresse à un gaz initialement confiné dans un compartiment d'une enceinte rigide et calorifugée. L'autre compartiment est vide. On retire brusquement la séparation, permettant au gaz de se détendre et d'occuper la totalité du volume. Nous allons analyser cette transformation pour un gaz parfait et en déduire ses propriétés clés, notamment en ce qui concerne son énergie interneSomme des énergies cinétiques et potentielles microscopiques d'un système. Pour un gaz parfait, elle ne dépend que de la température. et son entropieGrandeur thermodynamique qui mesure le degré de désordre d'un système. Elle augmente toujours lors d'une transformation irréversible d'un système isolé..
Remarque Pédagogique : Cet exercice est crucial pour comprendre la différence entre une transformation réversible et irréversible, et pour appliquer correctement le premier principe de la thermodynamique dans un cas où aucun travail ni aucune chaleur ne sont échangés.
Objectifs Pédagogiques
- Appliquer le premier principe de la thermodynamique à un système isolé.
- Démontrer que l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de sa température.
- Calculer les variations des grandeurs d'état (P, V, T) lors d'une transformation irréversible.
- Calculer la variation d'entropie et interpréter son signe en termes de réversibilité.
Données de l'étude
Schéma de l'expérience de Joule-Gay Lussac
| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| Quantité de matière | \(n\) | 1 | mol |
| Pression initiale | \(P_i\) | 2 | bar |
| Volume initial | \(V_i\) | 10 | L |
| Constante des gaz parfaits | \(R\) | 8.314 | J·mol⁻¹·K⁻¹ |
Questions à traiter
- Calculer la température initiale \(T_i\) du gaz en Kelvin.
- En appliquant le premier principe de la thermodynamique au système (gaz), déterminer la variation de son énergie interne \(\Delta U\) lors de la détente.
- En déduire la température finale \(T_f\) du gaz. Justifier votre raisonnement.
- Calculer la pression finale \(P_f\) du gaz en bar.
- Calculer la variation d'entropie \(\Delta S\) du gaz. Que pouvez-vous conclure sur la réversibilité de cette transformation ?
Les bases sur la Thermodynamique du Gaz Parfait
Pour résoudre cet exercice, il est essentiel de maîtriser quelques concepts et formules clés de la thermodynamique appliquée aux gaz parfaits.
1. Le Premier Principe de la Thermodynamique
Il exprime la conservation de l'énergie pour un système. La variation de son énergie interne \(\Delta U\) est égale à la somme du travail \(W\) et de la chaleur \(Q\) échangés avec l'extérieur :
\[ \Delta U = W + Q \]
2. Le Gaz Parfait
C'est un modèle idéalisé d'un gaz. Son état est décrit par l'équation d'état \(PV = nRT\). Une propriété fondamentale est que son énergie interne ne dépend que de sa température : \(U = U(T)\). Pour une transformation infinitésimale, \(dU = nC_{v,m}dT\), où \(C_{v,m}\) est la capacité thermique molaire à volume constant.
3. L'Entropie
L'entropie \(S\) est une fonction d'état qui mesure le désordre. Sa variation se calcule en imaginant un chemin réversible entre l'état initial et final. Pour un gaz parfait, sa variation s'exprime par :
\[ \Delta S = nC_{v,m} \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) + nR \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) \]
Correction : Détente de Joule-Gay Lussac d'un Gaz Parfait
Question 1 : Calculer la température initiale \(T_i\)
Principe
L'état initial d'un gaz parfait est entièrement défini par sa pression, son volume et sa quantité de matière. Nous pouvons donc utiliser l'équation d'état des gaz parfaits pour déterminer la seule inconnue : la température.
Mini-Cours
L'équation d'état des gaz parfaits, \(PV=nRT\), est une relation fondamentale qui lie les variables macroscopiques d'un gaz. \(P\) est la pression, \(V\) le volume, \(n\) la quantité de matière, \(T\) la température absolue, et \(R\) est la constante universelle des gaz parfaits. Elle modélise le comportement d'un gaz dont les molécules n'ont pas de volume propre et n'interagissent pas entre elles, sauf par des collisions élastiques.
Remarque Pédagogique
Avant tout calcul en thermodynamique, la première étape est toujours d'identifier clairement l'état du système. Ici, nous connaissons \(P_i\), \(V_i\) et \(n\). L'équation d'état est l'outil direct pour trouver la variable manquante, \(T_i\).
Normes
En physique et en ingénierie, la cohérence des calculs est assurée par l'utilisation du Système International d'unités (SI). L'utilisation de la constante \(R = 8.314\) J·mol⁻¹·K⁻¹ impose que la pression soit en Pascals (Pa), le volume en mètres cubes (m³), et la quantité de matière en moles (mol) pour obtenir une température en Kelvin (K).
Formule(s)
L'équation d'état des gaz parfaits est l'outil mathématique central pour cette question.
Hypothèses
L'unique hypothèse est celle formulée dans l'énoncé : le gaz est considéré comme un gaz parfait.
Donnée(s)
Nous rassemblons les données numériques de l'énoncé nécessaires pour ce calcul.
| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| Pression initiale | \(P_i\) | 2 | bar |
| Volume initial | \(V_i\) | 10 | L |
| Quantité de matière | \(n\) | 1 | mol |
| Constante des gaz parfaits | \(R\) | 8.314 | J·mol⁻¹·K⁻¹ |
Astuces
Avant de vous lancer dans le calcul, vérifiez toujours les unités. Une erreur de conversion est la source la plus fréquente d'échec dans ce type d'exercice. Pensez : \(1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}\) et \(1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3\).
Schéma (Avant les calculs)
Le schéma pertinent est celui de l'état initial, montrant le gaz confiné dans le premier compartiment.
État Initial du Système
Calcul(s)
Étape 1 : Conversion des unités en SI
Étape 2 : Application numérique
Schéma (Après les calculs)
Le calcul nous a donné la température. Nous pouvons maintenant représenter l'état initial avec toutes ses grandeurs connues.
État Initial Caractérisé
Réflexions
Une température de 240.6 K correspond à environ -32.6 °C. C'est une température froide mais physiquement réaliste pour un gaz sous une pression de 2 bars. Le résultat est cohérent.
Points de vigilance
La principale erreur à éviter est le mélange d'unités. Si vous aviez utilisé les bars et les litres directement, le résultat aurait été incorrect de plusieurs ordres de grandeur. La conversion préalable est une étape non négociable.
Points à retenir
- L'équation d'état des gaz parfaits \(PV=nRT\) est l'outil de base pour décrire l'état d'un gaz.
- La cohérence des unités via le Système International est fondamentale pour l'application numérique.
Le saviez-vous ?
L'échelle de température Kelvin, utilisée en science, a été proposée par William Thomson (Lord Kelvin) en 1848. Son point de départ, le zéro absolu (0 K), est la température la plus basse possible, où toute agitation thermique des particules cesserait selon la physique classique.
FAQ
Résultat Final
A vous de jouer
Si la pression initiale était de 3 bars pour le même volume, quelle serait la nouvelle température initiale ?
Question 2 : Déterminer la variation d'énergie interne \(\Delta U\)
Principe
Le concept physique clé est le premier principe de la thermodynamique, qui est une formulation de la conservation de l'énergie. Il stipule que la variation de l'énergie interne d'un système est égale à la somme des énergies échangées avec l'extérieur sous forme de travail et de chaleur.
Mini-Cours
L'énergie interne \(U\) est une fonction d'état : sa variation \(\Delta U\) ne dépend que des états initial et final, pas du chemin suivi. Le travail \(W\) et la chaleur \(Q\) ne sont pas des fonctions d'état ; ce sont des modes de transfert d'énergie. Pour une transformation, on écrit \(\Delta U = W + Q\). Le travail des forces de pression est donné par \(W = - \int P_{\text{ext}} dV\). Un processus sans échange de chaleur (\(Q=0\)) est dit adiabatique.
Remarque Pédagogique
Pour appliquer le premier principe, il faut analyser méthodiquement les interactions du système (le gaz) avec son environnement. Posez-vous toujours deux questions : 1) Le système reçoit-il ou fournit-il du travail ? 2) Le système reçoit-il ou cède-t-il de la chaleur ?
Normes
La convention de signe utilisée est la convention internationale : l'énergie reçue par le système (travail ou chaleur) est comptée positivement, tandis que l'énergie fournie par le système est comptée négativement. C'est le standard dans la plupart des ouvrages de physique et de chimie.
Formule(s)
L'outil mathématique est l'expression du premier principe.
Hypothèses
L'analyse repose sur deux hypothèses cruciales tirées de l'énoncé :
- Enceinte calorifugée : Le système {gaz} est thermiquement isolé de l'extérieur. Il n'y a donc aucun échange de chaleur : \(Q=0\).
- Détente dans le vide : Le gaz se détend contre une pression extérieure nulle (\(P_{\text{ext}}=0\)). Le travail des forces de pression est donc nul : \(W=0\).
Donnée(s)
Aucune donnée chiffrée n'est nécessaire pour cette question, la réponse est qualitative et découle directement des hypothèses.
Astuces
Le terme "détente de Joule-Gay Lussac" doit immédiatement vous alerter : il s'agit d'une détente adiabatique (\(Q=0\)) dans le vide (\(W=0\)). Par conséquent, \(\Delta U\) est toujours nulle pour ce type de transformation, quel que soit le gaz.
Schéma (Avant les calculs)
Le schéma représente le processus complet, où le système (le gaz) est contenu dans une enceinte rigide et isolée, n'échangeant ni travail ni chaleur avec l'extérieur.
Système Isolé pendant la Détente
Calcul(s)
L'application du premier principe est directe à partir des hypothèses.
Schéma (Après les calculs)
Le résultat est une valeur. On peut le visualiser par un diagramme montrant que le niveau d'énergie interne du système n'a pas changé entre l'état initial et l'état final.
Conservation de l'Énergie Interne
Réflexions
Le résultat \(\Delta U=0\) signifie que l'énergie interne du gaz est restée constante pendant la transformation. C'est un résultat puissant qui va nous permettre de tirer des conclusions sur la température du gaz, car pour un gaz parfait, l'énergie interne et la température sont directement liées.
Points de vigilance
Ne confondez pas "adiabatique" (\(Q=0\)) et "isotherme" (\(\Delta T=0\)). Une transformation peut être adiabatique sans être isotherme (par exemple, une compression adiabatique réversible chauffe le gaz). C'est la combinaison des conditions \(Q=0\) ET \(W=0\) qui est spécifique ici.
Points à retenir
- Le premier principe \(\Delta U = W+Q\) est universel.
- Une détente dans le vide implique un travail nul (\(W=0\)).
- Une transformation dans une enceinte calorifugée est adiabatique (\(Q=0\)).
Le saviez-vous ?
James Prescott Joule a mené cette expérience vers 1845. Ses instruments n'étaient pas assez précis pour détecter la faible variation de température d'un gaz réel, ce qui l'a conduit à postuler (correctement pour un gaz parfait) que l'énergie interne ne dépendait que de la température.
FAQ
Résultat Final
A vous de jouer
Si le gaz s'était détendu contre une pression extérieure constante de 0.5 bar (au lieu du vide), la variation d'énergie interne \(\Delta U\) aurait-elle été nulle, positive ou négative ?
(Indice : Le travail \(W\) serait-il nul ?)
Question 3 : En déduire la température finale \(T_f\)
Principe
Le concept physique utilisé est la première loi de Joule pour les gaz parfaits, qui stipule que l'énergie interne d'un gaz parfait est une fonction exclusive de sa température. Toute variation de l'une entraîne une variation de l'autre.
Mini-Cours
Pour un gaz parfait, la variation d'énergie interne \(\Delta U\) entre deux états est toujours donnée par \(\Delta U = n \int_{T_i}^{T_f} C_{v,m}(T) dT\). Si la capacité thermique molaire à volume constant \(C_{v,m}\) est supposée constante (ce qui est une excellente approximation pour de nombreux gaz sur de larges plages de température), la relation se simplifie en \(\Delta U = nC_{v,m}(T_f - T_i)\).
Remarque Pédagogique
C'est une question de pur raisonnement. Vous avez prouvé à la question 2 que \(\Delta U = 0\). Vous savez que pour un gaz parfait, \(U\) ne dépend que de \(T\). La conclusion est directe : si l'énergie interne n'a pas changé, la température non plus.
Normes
Il n'y a pas de norme réglementaire ici, mais la première loi de Joule est une loi fondamentale de la thermodynamique des gaz parfaits, validée par l'expérience (dans la limite du modèle).
Formule(s)
La relation mathématique clé est la dépendance de l'énergie interne avec la température.
Hypothèses
Nous nous appuyons sur deux éléments : l'hypothèse que le gaz est parfait et le résultat de la question précédente, \(\Delta U = 0\).
Donnée(s)
La seule donnée numérique nécessaire est la température initiale calculée précédemment.
| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| Température initiale | \(T_i\) | 240.6 | K |
Astuces
Ne cherchez pas à calculer \(C_{v,m}\). Sa valeur n'a aucune importance ici. Puisque \(n\) et \(C_{v,m}\) sont des constantes non nulles, le seul moyen pour que le produit \(nC_{v,m}(T_f - T_i)\) soit nul est que le terme \((T_f - T_i)\) soit nul.
Schéma (Avant les calculs)
Le schéma illustre la relation directe entre l'énergie interne et la température pour un gaz parfait. Une variation nulle de l'un implique une variation nulle de l'autre.
Relation U-T pour un Gaz Parfait
Calcul(s)
Le calcul est une simple déduction logique.
Puisque \(n \neq 0\) et \(C_{v,m} \neq 0\) :
Schéma (Après les calculs)
Le schéma montre que la température, représentée par un thermomètre, est au même niveau pour l'état initial et l'état final.
Conservation de la Température
Réflexions
Ce résultat peut sembler contre-intuitif. On pourrait s'attendre à ce qu'un gaz qui se détend se refroidisse. Cela est vrai pour une détente adiabatique réversible (où le gaz fournit un travail), mais pas pour une détente dans le vide où aucun travail n'est fourni. L'énergie cinétique moyenne des molécules reste la même.
Points de vigilance
Attention, ce résultat (\(T_f = T_i\)) n'est vrai que pour un gaz parfait. Pour un gaz réel, les forces intermoléculaires (forces de van der Waals) entrent en jeu. L'expansion du gaz nécessite de "lutter" contre ces forces d'attraction, ce qui consomme de l'énergie interne et provoque un léger refroidissement (effet Joule-Thomson).
Points à retenir
- Première loi de Joule : L'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de sa température.
- Une détente de Joule-Gay Lussac d'un gaz parfait est isotherme.
Le saviez-vous ?
L'effet de refroidissement lors de la détente d'un gaz réel est utilisé dans la plupart des systèmes de réfrigération et de climatisation. Le fluide frigorigène subit une détente à travers un détendeur, ce qui provoque sa vaporisation et un fort refroidissement, permettant d'absorber la chaleur de l'enceinte à refroidir.
FAQ
Résultat Final
A vous de jouer
Un gaz réel subit la même expérience. Sa température finale sera-t-elle égale, supérieure ou inférieure à 240.6 K ?
Question 4 : Calculer la pression finale \(P_f\)
Principe
Le concept est à nouveau l'utilisation de l'équation d'état des gaz parfaits. Connaissant l'état final du gaz (volume, température, quantité de matière), on peut en déduire sa pression.
Mini-Cours
Pour une quantité donnée de gaz parfait (\(n\) constant) subissant une transformation isotherme (\(T\) constante), l'équation d'état \(PV=nRT\) implique que le produit \(PV\) est constant. C'est la loi de Boyle-Mariotte : \(P_iV_i = P_fV_f\). Elle décrit comment la pression d'un gaz augmente lorsque son volume diminue, et vice-versa, à température constante.
Remarque Pédagogique
Nous avons toutes les informations sur l'état final, sauf la pression. C'est donc une application directe de l'équation d'état. Reconnaître qu'il s'agit d'une transformation isotherme permet d'utiliser une forme simplifiée (Boyle-Mariotte), ce qui est plus élégant et rapide.
Normes
Aucune norme spécifique, si ce n'est la cohérence des unités. Si vous utilisez la loi de Boyle-Mariotte, vous pouvez garder n'importe quelle unité pour la pression (ex: bar) et le volume (ex: L), à condition d'utiliser la même pour les états initial et final.
Formule(s)
Ou, de manière équivalente, la loi de Boyle-Mariotte :
Hypothèses
On continue de supposer que le gaz est parfait et on utilise les résultats des questions précédentes (\(T_f = T_i\)).
Donnée(s)
Nous avons besoin des conditions initiales et du volume final.
| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| Pression initiale | \(P_i\) | 2 | bar |
| Volume initial | \(V_i\) | 10 | L |
| Volume final | \(V_f\) | \(10 + 10 = 20\) | L |
Astuces
Le volume a doublé, et la température est restée constante. Intuitivement, les molécules frappent les parois deux fois moins souvent. La pression devrait donc être divisée par deux. C'est une bonne façon de vérifier rapidement son résultat.
Schéma (Avant les calculs)
Le schéma montre la transition de l'état initial (connu) à l'état final où le volume a changé.
Transition de Volume
Calcul(s)
En utilisant la loi de Boyle-Mariotte, le calcul est très direct.
Schéma (Après les calculs)
On peut représenter la transformation dans un diagramme de Clapeyron (P, V). La détente de Joule-Gay Lussac est un saut d'un point initial à un point final sur la même isotherme. Ce n'est pas une courbe continue car la transformation est irréversible et les états intermédiaires ne sont pas définis.
Diagramme de Clapeyron (P, V)
Réflexions
Le résultat est conforme à l'intuition : en doublant le volume à température constante, on divise la pression par deux. Cela montre la relation inversement proportionnelle entre pression et volume pour un gaz parfait à température constante.
Points de vigilance
Ne soyez pas tenté de dessiner un chemin (une courbe) entre l'état initial et l'état final dans le diagramme (P, V). La transformation est irréversible, le système n'est pas à l'équilibre pendant la détente, et la pression n'est pas définie de manière homogène dans le volume. On ne peut représenter que les points de départ et d'arrivée.
Points à retenir
- La loi de Boyle-Mariotte (\(P_iV_i = P_fV_f\)) est un cas particulier de la loi des gaz parfaits pour une transformation isotherme à \(n\) constant.
Le saviez-vous ?
Robert Boyle (1662) et Edme Mariotte (1676) ont découvert cette loi indépendamment. Mariotte a en plus précisé qu'elle n'était valable qu'à température constante, une condition essentielle que Boyle n'avait pas explicitement mentionnée.
FAQ
Résultat Final
A vous de jouer
Si le second compartiment avait un volume de 20 L (volume final total de 30 L), quelle serait la pression finale en bar ?
Question 5 : Calculer la variation d'entropie \(\Delta S\)
Principe
Le concept physique est le second principe de la thermodynamique et la notion d'entropie comme mesure du désordre. Comme l'entropie est une fonction d'état, sa variation ne dépend que des états initial et final. Pour la calculer, on doit imaginer un chemin réversible qui relie ces deux états.
Mini-Cours
La variation d'entropie pour un système fermé est \(\Delta S = \int \frac{\delta Q_{\text{rev}}}{T}\). Pour un gaz parfait, cette formule s'intègre pour donner \(\Delta S = nC_{v,m} \ln(T_f/T_i) + nR \ln(V_f/V_i)\). Le second principe stipule que pour un système isolé, l'entropie créée est toujours positive ou nulle (\(\Delta S_{\text{isolé}} \ge 0\)). Le cas \(\Delta S = 0\) correspond à une transformation réversible, tandis que \(\Delta S > 0\) correspond à une transformation irréversible.
Remarque Pédagogique
La détente est irréversible, mais pour calculer \(\Delta S\), on imagine un chemin réversible. Puisque \(T_f=T_i\) et \(V_f \neq V_i\), le chemin réversible le plus simple est une détente isotherme réversible de \(V_i\) à \(V_f\).
Normes
Il n'y a pas de norme, mais le signe de la variation d'entropie est un indicateur universel de la nature d'une transformation dans un système isolé. Un \(\Delta S > 0\) est la signature d'un processus spontané et irréversible.
Formule(s)
L'outil mathématique est la formule de la variation d'entropie pour un gaz parfait.
Hypothèses
On utilise les résultats précédents : le gaz est parfait, et la transformation est isotherme (\(T_f = T_i\)).
Donnée(s)
Les données nécessaires sont les volumes initial et final, et la constante des gaz parfaits.
| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| Volume initial | \(V_i\) | 10 | L |
| Volume final | \(V_f\) | 20 | L |
| Constante des gaz parfaits | \(R\) | 8.314 | J·mol⁻¹·K⁻¹ |
Astuces
Puisque la transformation est isotherme, le terme en \(\ln(T_f/T_i)\) s'annule immédiatement car \(\ln(1)=0\). Le calcul se simplifie grandement. Le gaz se détend, le désordre augmente, on s'attend donc intuitivement à \(\Delta S > 0\).
Schéma (Avant les calculs)
Le schéma illustre l'augmentation du désordre : les molécules de gaz ont plus d'espace à explorer, ce qui correspond à une augmentation de l'entropie.
Augmentation du Désordre Moléculaire
Calcul(s)
Comme \(T_f = T_i\), le premier terme de la formule est nul.
Schéma (Après les calculs)
On peut visualiser le résultat par un diagramme montrant une augmentation nette de l'entropie entre l'état initial et l'état final.
Augmentation de l'Entropie
Réflexions
Le résultat \(\Delta S \approx +5.76\) J/K est strictement positif. Cela signifie que l'entropie du gaz a augmenté. Comme le système {gaz} est isolé (car l'enceinte globale est isolée), cette augmentation de l'entropie est l'entropie créée. Un processus qui crée de l'entropie est par définition irréversible. Le gaz ne retournera jamais spontanément dans son compartiment initial.
Points de vigilance
Ne concluez pas que la transformation est réversible parce qu'elle est isotherme. Une transformation isotherme peut être réversible (si elle est menée très lentement) ou irréversible (comme ici). C'est le signe de la variation d'entropie de l'univers (ou du système isolé) qui est le seul vrai critère de réversibilité.
Points à retenir
- La variation d'entropie se calcule toujours sur un chemin réversible fictif.
- Pour un système isolé, \(\Delta S > 0\) implique une transformation irréversible.
- L'expansion spontanée d'un gaz est un exemple paradigmatique d'augmentation de l'entropie.
Le saviez-vous ?
Le concept d'entropie a été introduit par Rudolf Clausius en 1865. Il a résumé les deux premiers principes de la thermodynamique par la célèbre phrase : "L'énergie de l'univers est constante. L'entropie de l'univers tend vers un maximum."
FAQ
Résultat Final
A vous de jouer
Si le volume final était de 40 L (au lieu de 20 L), quelle serait la nouvelle variation d'entropie en J/K ?
Outil Interactif : Simulateur de Détente
Utilisez les curseurs pour modifier les conditions initiales (pression, volume) et le volume final. Observez comment la pression finale et la création d'entropie sont affectées. La température reste constante pour ce gaz parfait.
Paramètres d'Entrée
Résultats Clés
Quiz Final : Testez vos connaissances
1. Lors d'une détente de Joule-Gay Lussac, le travail des forces de pression est :
2. Pour un gaz parfait subissant cette détente, sa température finale est :
3. La variation d'énergie interne \(\Delta U\) du gaz lors de ce processus est :
4. La détente de Joule-Gay Lussac est un processus :
5. La variation d'entropie \(\Delta S\) du gaz (système) est :
Glossaire
- Processus Adiabatique
- Une transformation thermodynamique qui se produit sans aucun échange de chaleur entre le système et son environnement (\(Q=0\)).
- Énergie Interne (U)
- La somme de toutes les énergies microscopiques (cinétique et potentielle) des particules constituant un système. Pour un gaz parfait, elle ne dépend que de la température.
- Entropie (S)
- Une fonction d'état qui quantifie le désordre ou le nombre d'états microscopiques accessibles à un système. Selon le second principe, l'entropie d'un système isolé ne peut qu'augmenter ou rester constante.
- Processus Irréversible
- Une transformation qui, une fois effectuée, ne peut pas être inversée pour ramener spontanément le système et l'environnement à leurs états initiaux. Toutes les transformations naturelles sont irréversibles.
D’autres exercices de thermodynamique classique:
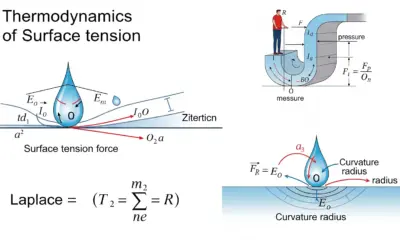
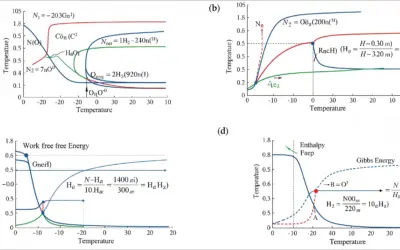
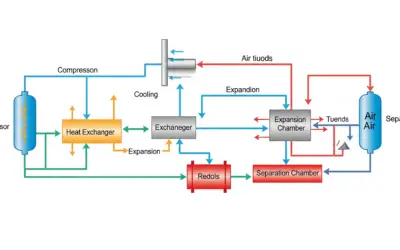
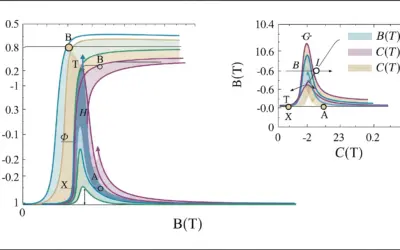
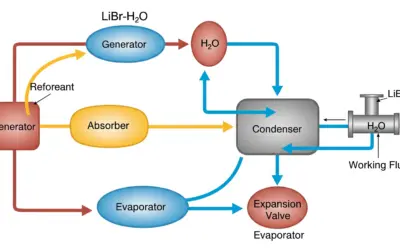
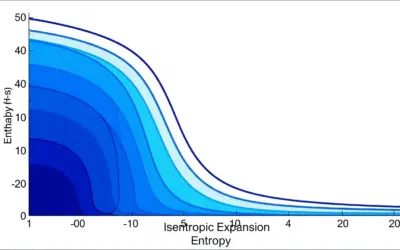
0 commentaires