Modèle d’Ising pour le Ferromagnétisme
Contexte : Le FerromagnétismePropriété de certains matériaux (comme le fer) à s'aimanter fortement sous l'effet d'un champ magnétique et à conserver cette aimantation..
Le ferromagnétisme est un phénomène fascinant où les moments magnétiques microscopiques (spins) d'un matériau s'alignent spontanément, créant une aimantation macroscopique. Pour comprendre ce phénomène, la thermodynamique statistique utilise des modèles simplifiés. Le plus célèbre est le Modèle d'IsingUn modèle en mécanique statistique pour décrire le ferromagnétisme, basé sur des spins discrets (+1 ou -1) sur un réseau., qui considère des spins ne pouvant prendre que deux états (haut '↑' ou bas '↓'). Dans cet exercice, nous allons résoudre analytiquement le cas le plus simple : une chaîne à une dimension (1D).
Remarque Pédagogique : Cet exercice vous apprendra à utiliser la méthode de la matrice de transfertUn outil mathématique puissant pour calculer la fonction de partition des systèmes 1D en transformant une somme sur N spins en un produit de matrices.. C'est une technique fondamentale en physique statistique pour comprendre comment un comportement collectif (l'ordre magnétique) émerge d'interactions locales simples entre voisins.
Objectifs Pédagogiques
- Comprendre et écrire l'HamiltonienL'opérateur ou la fonction qui représente l'énergie totale d'un système physique (ici, l'énergie de la chaîne de spins). du modèle d'Ising 1D.
- Appliquer la méthode de la matrice de transfert pour calculer la fonction de partitionUne quantité centrale en thermodynamique statistique ($Z$) qui contient toute l'information sur les propriétés thermodynamiques du système à l'équilibre. \(Z_N\).
- Dériver les grandeurs thermodynamiques (énergie moyenne, magnétisation) à partir de \(Z_N\).
- Comprendre pourquoi le modèle 1D n'a pas de transition de phase (pas de \(T_c > 0\)).
Données de l'étude
Fiche Technique
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Modèle | Modèle d'Ising 1D |
| Spins | \(N\) spins discrets, \(s_i \in \{-1, +1\}\) |
| Interactions | Plus proches voisins (constante \(J\)) |
| Hamiltonien | \(\mathcal{H} = -J \sum_{i=1}^{N-1} s_i s_{i+1} - H \sum_{i=1}^N s_i\) |
Schéma de la chaîne d'Ising 1D
| Nom du Paramètre | Description ou Formule | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| Constante de couplage | \(J\) (Si \(J>0\), ferromagnétique) | \(J\) | \(\text{Joules (J)}\) |
| Champ magnétique | \(H\) | \(H\) | \(\text{Tesla (T)}\) (ou A/m) |
| Température inverse | \(\beta = 1 / (k_B T)\) | \(\beta\) | \(\text{J}^{-1}\) |
Questions à traiter
- Écrire l'Hamiltonien \(\mathcal{H}\) pour un système simple de \(N=3\) spins (chaîne ouverte).
- Pour simplifier le calcul de \(Z_N = \sum_{\{s_i\}} e^{-\beta \mathcal{H}}\), on pose \(H=0\). Écrire la matrice de transfert \(T\) 2x2 qui relie le spin \(s_i\) au spin \(s_{i+1}\).
- Calculer les valeurs propres (\(\lambda_1, \lambda_2\)) de cette matrice de transfert \(T\).
- En utilisant la trace, \(Z_N = \operatorname{Tr}(T^N)\), exprimer la fonction de partition pour \(N\) spins (en supposant \(N\) grand et des conditions périodiques).
- Calculer l'énergie moyenne par spin \(u = U/N\) dans la limite thermodynamique (\(N \to \infty\)) et commenter le résultat.
Les bases de la Thermodynamique Statistique
Pour résoudre cet exercice, nous avons besoin des outils de l'ensemble canonique. L'état d'un système à une température \(T\) est décrit par la probabilité d'occuper un micro-état \(\{s_i\}\) d'énergie \(E(\{s_i\})\) : \(P(\{s_i\}) = e^{-\beta E(\{s_i\})} / Z\).
1. La Fonction de Partition (\(Z\))
C'est la quantité centrale. Elle est la somme des "poids" de Boltzmann sur tous les états possibles du système.
\[ Z = \sum_{\text{tous les états}} e^{-\beta E_{\text{état}}} \]
Pour nos \(N\) spins, il y a \(2^N\) états possibles. Elle normalise les probabilités (\(\sum P = 1\)) et contient implicitement toutes les informations sur l'équilibre thermodynamique.
2. Dériver les grandeurs thermodynamiques
Une fois \(Z\) connue, on obtient tout ! L'énergie libre de Helmholtz \(F = -k_B T \ln Z = - \frac{1}{\beta} \ln Z\) est le potentiel thermodynamique associé à l'ensemble canonique (N, V, T constants).
L'énergie interne moyenne \(U\), qui est la moyenne statistique de l'Hamiltonien, est obtenue par :
\[ U = \langle \mathcal{H} \rangle = \sum_{\text{états}} E_{\text{état}} P_{\text{état}} = -\frac{\partial (\ln Z)}{\partial \beta} \]
La magnétisation moyenne \(M\) (aimantation totale), moyenne de la somme des spins, est obtenue par (attention au signe, parfois défini différemment) :
\[ M = \langle \sum_i s_i \rangle = \frac{1}{\beta} \frac{\partial (\ln Z)}{\partial H} \]
D'autres grandeurs comme l'entropie \(S = (U-F)/T\) ou la capacité calorifique \(C_v = \partial U / \partial T\) peuvent aussi être dérivées.
Correction : Modèle d’Ising pour le Ferromagnétisme
Question 1 : Écrire l'Hamiltonien \(\mathcal{H}\) pour \(N=3\) spins.
Principe
L'Hamiltonien, \(\mathcal{H}\), représente l'énergie totale d'une configuration spécifique des spins. Il est construit en additionnant les contributions énergétiques de toutes les interactions pertinentes. Pour le modèle d'Ising, ces interactions sont de deux types : l'interaction entre spins voisins (\(-J s_i s_{i+1}\)) et l'interaction de chaque spin individuel avec le champ magnétique extérieur (\(-H s_i\)). Pour \(N=3\), nous devons simplement identifier toutes les paires de voisins et tous les spins individuels, puis sommer leurs contributions énergétiques respectives.
Mini-Cours
L'Hamiltonien est un concept central en physique. En mécanique classique, il représente l'énergie totale (cinétique + potentielle). En mécanique quantique, c'est un opérateur dont les valeurs propres sont les niveaux d'énergie possibles. En mécanique statistique, même si on travaille souvent classiquement comme ici, l'Hamiltonien \(\mathcal{H}(\{s_i\})\) reste la fonction qui donne l'énergie pour une configuration \(\{s_i\}\). Cette énergie détermine la probabilité de trouver le système dans cet état via le facteur de Boltzmann \(e^{-\beta \mathcal{H}}\).
Remarque Pédagogique
Pour construire l'Hamiltonien d'un système discret comme celui-ci, la méthode systématique est de : 1) Lister tous les types d'interactions possibles (ici : paires voisines, champ externe). 2) Pour chaque type, identifier tous les éléments concernés (ici : paires \((1,2), (2,3)\) ; spins \(1, 2, 3\)). 3) Écrire la contribution énergétique de chaque élément identifié. 4) Sommer toutes ces contributions. Cela évite les oublis et les doubles comptages.
Normes
La convention physique standard pour l'Hamiltonien d'Ising est d'utiliser le signe "-" devant les termes d'interaction et de champ. Ainsi, un \(J>0\) (cas ferromagnétique) favorise les spins alignés (\(s_i s_{i+1}=+1\)), ce qui minimise l'énergie (\(-J s_i s_{i+1} = -J\)). De même, un \(H>0\) favorise les spins alignés avec le champ (\(s_i=+1\)), ce qui minimise l'énergie (\(-H s_i = -H\)).
Formule(s)
La formule générale de l'Hamiltonien d'Ising pour une chaîne de \(N\) spins avec interaction aux plus proches voisins et champ externe est :
Le premier terme somme sur les \(N-1\) paires de voisins (\(i, i+1\)). Le second terme somme sur les \(N\) spins individuels. Nous devons appliquer cette formule au cas spécifique \(N=3\).
Hypothèses
L'énoncé précise "chaîne ouverte". Cela signifie que le système est une ligne finie et que le dernier spin (\(s_3\)) n'interagit pas avec le premier (\(s_1\)). C'est crucial car cela limite la somme des interactions de paires à \(i=1\) et \(i=2\). L'autre hypothèse implicite du modèle d'Ising standard est que seuls les plus proches voisins interagissent.
- Chaîne ouverte : pas d'interaction entre \(s_3\) et \(s_1\).
- Interaction limitée aux plus proches voisins (\(i, i+1\)).
Donnée(s)
La seule donnée numérique spécifique à cette question est le nombre de spins \(N=3\). Les paramètres \(J\) et \(H\) restent sous forme littérale, représentant respectivement la force de l'interaction de couplage et l'intensité du champ magnétique externe.
| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| Nombre de spins | N | 3 | Sans unité |
Astuces
Pour éviter les erreurs d'indice dans les sommes, écrivez explicitement les termes pour N petit. Pour N=3, la somme \(\sum_{i=1}^{N-1}\) devient \(\sum_{i=1}^{2}\), incluant les termes pour \(i=1\) et \(i=2\). La somme \(\sum_{i=1}^{N}\) devient \(\sum_{i=1}^{3}\), incluant les termes pour \(i=1, 2, 3\).
Schéma (Avant les calculs)
Visualisons la chaîne de 3 spins. Les cercles représentent les spins, et les lignes pointillées les interactions \(J\) entre voisins. Le champ \(H\) s'applique à chaque spin individuellement (non représenté graphiquement ici mais implicite).
Chaîne d'Ising N=3 (ouverte)
Calcul(s)
On particularise la formule générale pour \(N=3\).
Terme d'interaction : La somme va de \(i=1\) à \(N-1 = 2\).
Terme de champ : La somme va de \(i=1\) à \(N = 3\).
Hamiltonien complet : Somme des deux termes.
Schéma (Après les calculs)
Le calcul étant une simple application de formule, il n'y a pas de schéma spécifique pour visualiser le résultat, autre que l'expression mathématique elle-même.
Réflexions
L'expression obtenue \(\mathcal{H} = -J(s_1 s_2 + s_2 s_3) - H(s_1 + s_2 + s_3)\) montre bien que l'énergie dépend de l'orientation relative des spins voisins (\(s_1 s_2, s_2 s_3\)) et de l'orientation de chaque spin par rapport au champ (\(s_1, s_2, s_3\)). Par exemple, si \(J>0\) et \(H>0\), l'état \(\{+1, +1, +1\}\) a l'énergie la plus basse (\(-2J - 3H\)), tandis que l'état \(\{-1, -1, -1\}\) a une énergie \(-2J + 3H\). L'état \(\{+1, -1, +1\}\) a une énergie \(+2J - H\), montrant le coût énergétique (\(+2J\)) dû aux paires anti-alignées.
Points de vigilance
La principale source d'erreur ici est de mal interpréter les limites des sommes. Pour l'interaction entre voisins \(\sum_{i=1}^{N-1}\), la somme s'arrête bien à \(N-1\) car le \(N\)-ième spin n'a pas de voisin \(N+1\) dans une chaîne ouverte. Pour le terme de champ \(\sum_{i=1}^{N}\), on somme bien sur tous les \(N\) spins. Ne pas confondre les deux.
Points à retenir
- L'Hamiltonien d'Ising décompose l'énergie en contributions d'interactions de paires et de champ externe.
- Pour une chaîne ouverte de \(N\) spins, il y a \(N-1\) termes d'interaction de paires et \(N\) termes de champ.
- Le signe \(-J\) avec \(J>0\) favorise l'alignement parallèle des spins voisins pour minimiser l'énergie.
Le saviez-vous ?
Le modèle d'Ising, malgré sa simplicité apparente (spins binaires, interactions locales), capture l'essence des transitions de phase et est devenu un paradigme en physique statistique. Il a des applications bien au-delà du magnétisme, par exemple en sciences sociales (modélisation d'opinions), en biologie (repliement des protéines) ou en informatique (optimisation).
FAQ
Questions fréquentes sur l'écriture de l'Hamiltonien.
Résultat Final
A vous de jouer
Calculez l'énergie \(\mathcal{H}\) (en termes de \(J\) et \(H\)) pour la configuration "antiferromagnétique" : \(s_1=+1, s_2=-1, s_3=+1\).
Mini Fiche Mémo
Synthèse Q1 :
- Concept Clé : Hamiltonien = Énergie totale du système pour une configuration donnée.
- Calcul : Somme des contributions énergétiques : \(-J \sum \text{paires} s_i s_{i+1}\) et \(-H \sum \text{spins} s_i\).
- Attention : Bien définir les limites des sommes (chaîne ouverte vs périodique).
Question 2 : Écrire la matrice de transfert \(T\) pour \(H=0\).
Principe
La fonction de partition \(Z_N\) est une somme sur \(2^N\) états exponentiellement complexe à calculer directement. L'astuce pour un système 1D avec interactions de proches voisins est de réécrire l'exponentielle de la somme des énergies comme un produit d'exponentielles, où chaque facteur ne dépend que de deux spins voisins. Pour \(H=0\), \(\mathcal{H} = -J \sum_{i=1}^{N-1} s_i s_{i+1}\), donc \(e^{-\beta \mathcal{H}} = e^{\beta J \sum s_i s_{i+1}} = \prod_{i=1}^{N-1} e^{\beta J s_i s_{i+1}}\). La somme \(Z_N = \sum_{s_1...s_N} \prod_{i=1}^{N-1} e^{\beta J s_i s_{i+1}}\) peut alors être vue comme une multiplication matricielle répétée. Le terme \(e^{\beta J s_i s_{i+1}}\) est défini comme l'élément \((s_i, s_{i+1})\) d'une matrice 2x2, appelée matrice de transfert \(T\).
Mini-Cours
La méthode de la matrice de transfert, introduite par Kramers et Wannier, est une technique fondamentale en physique statistique pour les systèmes 1D. Elle permet de calculer exactement la fonction de partition \(Z_N\). L'idée est que la somme sur toutes les configurations possibles de la chaîne peut être effectuée séquentiellement, site par site, en multipliant les matrices de transfert. Pour une chaîne ouverte, \(Z_N\) est un élément de matrice de \(T^{N-1}\) (plus précisément \(v_{\text{init}}^T T^{N-1} v_{\text{end}}\)), tandis que pour une chaîne périodique, \(Z_N = \operatorname{Tr}(T^N)\).
Remarque Pédagogique
Le passage clé est de comprendre comment la somme sur les spins intermédiaires se transforme en produit matriciel. Considérons 3 spins : \(Z_3 = \sum_{s_1,s_2,s_3} e^{\beta J s_1 s_2} e^{\beta J s_2 s_3}\). En définissant \(T_{s_i, s_{i+1}} = e^{\beta J s_i s_{i+1}}\), on peut écrire \(Z_3 = \sum_{s_1, s_3} \left( \sum_{s_2} T_{s_1, s_2} T_{s_2, s_3} \right)\). La somme sur \(s_2\) est exactement la définition du produit matriciel \((T^2)_{s_1, s_3}\). Donc \(Z_3 = \sum_{s_1, s_3} (T^2)_{s_1, s_3}\). Généraliser à N spins mène à \(T^{N-1}\) (ou \(T^N\) pour périodique).
Normes
La définition standard de la matrice de transfert \(T\) est que son élément \(T_{a,b}\) est le facteur de Boltzmann associé à l'interaction entre un site dans l'état \(a\) et le site suivant dans l'état \(b\). Ici, les états sont \(a=s_i\) et \(b=s_{i+1}\), et l'interaction est \(-J s_i s_{i+1}\).
Formule(s)
L'élément de matrice \((s_i, s_{i+1})\) est donné par le facteur de Boltzmann de l'énergie d'interaction entre ces deux spins. Puisque \(\mathcal{H}_{\text{int}}(s_i, s_{i+1}) = -J s_i s_{i+1}\) et qu'on a posé \(H=0\) :
Il faut évaluer cette expression pour les 4 combinaisons possibles de \(s_i = \pm 1\) et \(s_{i+1} = \pm 1\).
Hypothèses
La simplification cruciale ici est de poser \(H=0\). Cela rend l'énergie d'interaction \(e^{\beta J s_i s_{i+1}}\) dépendante uniquement de la paire \((s_i, s_{i+1})\) et non des spins individuellement, ce qui permet la formulation matricielle simple. Si \(H \neq 0\), la matrice doit inclure aussi le terme de champ, ce qui est possible mais un peu plus complexe.
- Champ magnétique externe nul (\(H=0\)).
- Interaction limitée aux plus proches voisins.
Donnée(s)
Les paramètres \(J\) et \(\beta = 1/k_B T\) définissent les éléments de la matrice. Les états possibles des spins (\(+1, -1\)) définissent la dimension de la matrice (2x2).
| Paramètre | Symbole |
|---|---|
| Couplage | J |
| Température inverse | \(\beta\) |
Astuces
Pour construire la matrice, indexez les lignes par l'état du spin \(s_i\) (par convention : ligne 1 pour \(s_i=+1\), ligne 2 pour \(s_i=-1\)) et les colonnes par l'état du spin \(s_{i+1}\) (colonne 1 pour \(s_{i+1}=+1\), colonne 2 pour \(s_{i+1}=-1\)). Calculez ensuite les 4 valeurs \(e^{\beta J s_i s_{i+1}}\) correspondantes.
Schéma (Avant les calculs)
La structure de la matrice 2x2 est déterminée par les deux états possibles pour le spin "entrant" (\(s_i\)) et le spin "sortant" (\(s_{i+1}\)).
Construction de la Matrice de Transfert \(T\)
Calcul(s)
On évalue \(e^{\beta J s_i s_{i+1}}\) pour les quatre cas :
Élément (Ligne +, Colonne +) : \(s_i = +1, s_{i+1} = +1 \implies s_i s_{i+1} = +1\)
Élément (Ligne -, Colonne -) : \(s_i = -1, s_{i+1} = -1 \implies s_i s_{i+1} = +1\)
Élément (Ligne +, Colonne -) : \(s_i = +1, s_{i+1} = -1 \implies s_i s_{i+1} = -1\)
Élément (Ligne -, Colonne +) : \(s_i = -1, s_{i+1} = +1 \implies s_i s_{i+1} = -1\)
Schéma (Après les calculs)
En assemblant ces éléments, on obtient la matrice de transfert.
Matrice de Transfert \(T\) (H=0)
Réflexions
La matrice obtenue est symétrique : \(T_{+-} = T_{-+}\). Ceci est une conséquence directe de la symétrie de l'interaction (\(s_i s_{i+1} = s_{i+1} s_i\)) et de l'absence de champ magnétique (\(H=0\)). Les termes diagonaux \(e^{\beta J}\) représentent le poids statistique des configurations où les spins voisins sont alignés, tandis que les termes hors-diagonale \(e^{-\beta J}\) représentent celui des configurations anti-alignées. Pour \(J>0\), les termes diagonaux sont plus grands, favorisant l'alignement à basse température (\(\beta\) grand).
Points de vigilance
La principale erreur possible est de se tromper dans les signes lors du calcul du produit \(s_i s_{i+1}\) pour les termes hors diagonale, ou d'oublier que l'énergie est \(-J s_i s_{i+1}\) et que le facteur de Boltzmann est \(e^{-\beta \times \text{énergie}}\), ce qui donne \(e^{+\beta J s_i s_{i+1}}\). Une autre erreur serait d'inclure le terme de champ \(H\) alors qu'il a été spécifiquement demandé de le poser nul pour cette question.
Points à retenir
- La matrice de transfert \(T\) encode les poids statistiques des configurations locales de deux spins voisins.
- Pour le modèle d'Ising 1D avec \(H=0\), cette matrice est 2x2 et symétrique : \(T = \begin{pmatrix} e^{\beta J} & e^{-\beta J} \\ e^{-\beta J} & e^{\beta J} \end{pmatrix}\).
- Les éléments de \(T\) dépendent de la température via \(\beta = 1/k_B T\).
Le saviez-vous ?
Si l'on incluait le champ magnétique \(H\), le terme énergétique pour passer de \(s_i\) à \(s_{i+1}\) devrait aussi prendre en compte l'énergie du spin \(s_i\) dans le champ. Une définition courante (mais pas unique) de la matrice de transfert dans ce cas est \(T_{s_i, s_{i+1}} = e^{\beta J s_i s_{i+1} + \beta H (s_i + s_{i+1})/2}\). Le terme de champ est "partagé" entre les deux sites pour préserver une certaine symétrie.
FAQ
Questions sur la construction de la matrice de transfert.
Résultat Final
A vous de jouer
Que devient cette matrice à très haute température (\(T \to \infty\)) ? (Rappel : \(\beta = 1/k_B T \to 0\)). Écrivez la matrice sous forme de liste de listes, par ex. [[a, b], [c, d]].
Mini Fiche Mémo
Synthèse Q2 :
- Concept Clé : Matrice de Transfert \(T\) reliant les états de spins voisins.
- Méthode : \(T_{s_i, s_{i+1}} = e^{-\beta \times (\text{Energie d'interaction})}\).
- Résultat (H=0) : Matrice 2x2 symétrique avec \(e^{\beta J}\) sur la diagonale et \(e^{-\beta J}\) hors diagonale.
Question 3 : Calculer les valeurs propres (\(\lambda_1, \lambda_2\)) de \(T\).
Principe
Les valeurs propres d'une matrice sont des scalaires qui caractérisent ses propriétés intrinsèques, notamment comment elle transforme certains vecteurs (les vecteurs propres). Pour la matrice de transfert, ses valeurs propres sont fondamentales car la fonction de partition \(Z_N = \operatorname{Tr}(T^N)\) s'exprime directement comme la somme des puissances N-ièmes de ces valeurs propres : \(Z_N = \sum_i \lambda_i^N\). Pour trouver les valeurs propres \(\lambda\), on doit résoudre l'équation polynomiale (dite "équation caractéristique") obtenue en annulant le déterminant de la matrice \(T - \lambda I\), où \(I\) est la matrice identité.
Mini-Cours
En algèbre linéaire, les valeurs propres \(\lambda_i\) et les vecteurs propres \(v_i\) d'une matrice \(T\) satisfont \(T v_i = \lambda_i v_i\). Si une matrice est diagonalisable (ce qui est le cas de notre matrice \(T\) car elle est symétrique), on peut l'écrire comme \(T = P D P^{-1}\), où \(D\) est une matrice diagonale contenant les valeurs propres \(\lambda_i\) et \(P\) est la matrice dont les colonnes sont les vecteurs propres. Calculer \(T^N\) devient alors facile : \(T^N = P D^N P^{-1}\), où \(D^N\) est simplement la matrice diagonale avec les \(\lambda_i^N\).
Remarque Pédagogique
Le calcul des valeurs propres est une étape technique mais essentielle. L'équation \(\det(T - \lambda I) = 0\) mène à un polynôme en \(\lambda\) (le polynôme caractéristique) dont les racines sont les valeurs propres. Pour une matrice 2x2, c'est une équation du second degré, toujours soluble analytiquement. La factorisation \(a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)\) est une astuce très utile ici.
Normes
Les méthodes de calcul des valeurs propres (via le déterminant \(\det(T - \lambda I) = 0\) ou l'équation \(\lambda^2 - \operatorname{Tr}(T)\lambda + \det(T) = 0\)) relèvent de l'algèbre linéaire standard.
Formule(s)
Matrice \(T - \lambda I\)
On soustrait \(\lambda\) aux éléments diagonaux de \(T\).
Équation caractéristique : \(\det(T - \lambda I) = 0\)
Le déterminant d'une matrice 2x2 \(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\) est \(ad-bc\).
Hypothèses
Nous continuons avec la matrice \(T\) calculée sous l'hypothèse \(H=0\). Aucune nouvelle hypothèse physique n'est nécessaire pour ce calcul mathématique.
Donnée(s)
La matrice \(T = \begin{pmatrix} e^{\beta J} & e^{-\beta J} \\ e^{-\beta J} & e^{\beta J} \end{pmatrix}\).
Astuces
L'équation \((A-\lambda)^2 - B^2 = 0\) est de la forme \(X^2 - B^2 = 0\) avec \(X = A-\lambda\). La factorisation \(X^2 - B^2 = (X-B)(X+B)\) donne immédiatement les deux solutions : \(X = B\) et \(X = -B\), soit \(A-\lambda = B\) et \(A-\lambda = -B\). Cela évite de développer le carré et d'utiliser la formule quadratique.
Schéma (Avant les calculs)
Ce calcul est purement algébrique et ne se prête pas à une représentation schématique simple autre que l'écriture des matrices.
Calcul(s)
On résout l'équation caractéristique \((e^{\beta J} - \lambda)^2 - (e^{-\beta J})^2 = 0\).
Étape 1 : Factorisation (Identité \(a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)\))
Avec \(a = e^{\beta J} - \lambda\) et \(b = e^{-\beta J}\).
Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul.
Étape 2 : Annulation du Facteur 2 (donne \(\lambda_1\))
Étape 3 : Annulation du Facteur 1 (donne \(\lambda_2\))
Étape 4 : Simplification avec les fonctions hyperboliques
On utilise les définitions \(\cosh(x) = (e^x + e^{-x})/2\) et \(\sinh(x) = (e^x - e^{-x})/2\).
Schéma (Après les calculs)
On peut visualiser comment les valeurs propres varient avec \(\beta J = J/k_B T\). \(\lambda_1\) est toujours positive et croît exponentiellement quand \(T \to 0\). \(\lambda_2\) est positive pour \(J>0\), nulle à \(T=\infty\), et croît aussi exponentiellement vers \(+\infty\) quand \(T \to 0\), mais toujours \(\lambda_1 > \lambda_2\).
Réflexions
Nous avons trouvé les deux valeurs propres de la matrice de transfert. \(\lambda_1 = 2 \cosh(\beta J)\) et \(\lambda_2 = 2 \sinh(\beta J)\). Puisque \(\cosh(x) \ge 1\) et \(\cosh(x) > |\sinh(x)|\) pour \(x \neq 0\), \(\lambda_1\) est toujours la plus grande valeur propre (en module). Cette dominance de \(\lambda_1\) sera essentielle pour déterminer le comportement du système dans la limite thermodynamique (\(N \to \infty\)).
Points de vigilance
Une erreur courante est de mal appliquer l'identité \(a^2-b^2\) ou de faire une erreur de signe en isolant \(\lambda\). Une vérification rapide : la somme des valeurs propres doit être égale à la trace de la matrice (\(\lambda_1 + \lambda_2 = 2\cosh(\beta J) + 2\sinh(\beta J) = 2(e^{\beta J})\)). La trace de \(T\) est \(e^{\beta J} + e^{\beta J} = 2e^{\beta J}\). C'est correct. Le produit des valeurs propres doit être égal au déterminant (\(\lambda_1 \lambda_2 = (2\cosh(\beta J))(2\sinh(\beta J)) = 2\sinh(2\beta J)\)). Le déterminant de \(T\) est \(e^{2\beta J} - e^{-2\beta J} = 2\sinh(2\beta J)\). C'est correct aussi.
Points à retenir
- La résolution de \(\det(T - \lambda I) = 0\) donne les valeurs propres.
- Pour la matrice de transfert d'Ising 1D (H=0), les valeurs propres sont \(\lambda_1 = 2 \cosh(\beta J)\) et \(\lambda_2 = 2 \sinh(\beta J)\).
- \(\lambda_1\) est toujours la plus grande en module (pour \(J \neq 0, T \neq \infty\)).
Le saviez-vous ?
Les fonctions cosinus hyperbolique (\(\cosh\)) et sinus hyperbolique (\(\sinh\)) apparaissent très fréquemment en physique statistique, notamment dans les solutions de modèles sur réseau comme le modèle d'Ising. Elles sont définies par \(\cosh(x) = (e^x + e^{-x})/2\) et \(\sinh(x) = (e^x - e^{-x})/2\), et partagent de nombreuses propriétés similaires à leurs analogues trigonométriques (\(\cos\) et \(\sin\)).
FAQ
Questions relatives au calcul des valeurs propres.
Résultat Final
A vous de jouer
Laquelle de ces deux valeurs propres est la plus grande ? (Sachant \(\beta > 0\) et \(J > 0\)).
Mini Fiche Mémo
Synthèse Q3 :
- Concept Clé : Valeurs propres \(\lambda_i\) obtenues via \(\det(T - \lambda I) = 0\).
- Résultat (H=0) : \(\lambda_1 = 2 \cosh(\beta J)\) (dominante) et \(\lambda_2 = 2 \sinh(\beta J)\).
- Importance : Les \(\lambda_i\) déterminent \(Z_N\) et donc la thermodynamique.
Question 4 : Exprimer la fonction de partition \(Z_N\).
Principe
La méthode de la matrice de transfert atteint son objectif ici : exprimer la fonction de partition \(Z_N\), initialement une somme sur \(2^N\) états, en termes des valeurs propres de la matrice \(T\). Pour une chaîne avec conditions aux bords périodiques (le N-ième spin interagit avec le premier, formant une boucle), la fonction de partition est exactement égale à la trace de la matrice de transfert élevée à la puissance N : \(Z_N = \operatorname{Tr}(T^N)\). Or, la trace d'une matrice puissance N est simplement la somme des puissances N-ièmes de ses valeurs propres. Cette simplification est spectaculaire.
Mini-Cours
La trace d'une matrice carrée \(A\), notée \(\operatorname{Tr}(A)\), est la somme de ses éléments diagonaux. Une propriété fondamentale est qu'elle est invariante par changement de base (\(\operatorname{Tr}(P^{-1}AP) = \operatorname{Tr}(A)\)). Comme une matrice diagonalisable \(T\) peut s'écrire \(T = P D P^{-1}\) (où \(D\) est diagonale avec les valeurs propres \(\lambda_i\)), on a \(T^N = P D^N P^{-1}\). En prenant la trace : \(\operatorname{Tr}(T^N) = \operatorname{Tr}(P D^N P^{-1}) = \operatorname{Tr}(D^N)\) (par cyclicité de la trace ou invariance par changement de base). La trace de \(D^N\) est simplement la somme de ses éléments diagonaux, qui sont les \(\lambda_i^N\). D'où \(\operatorname{Tr}(T^N) = \sum_i \lambda_i^N\).
Remarque Pédagogique
Les conditions aux bords périodiques sont souvent utilisées en physique statistique car elles simplifient les calculs (comme ici avec la trace) tout en représentant correctement le comportement du "volume" du système dans la limite thermodynamique (\(N \to \infty\)). Pour N grand, la contribution des bords (ouverts ou périodiques) devient négligeable par rapport à celle du volume (\(\propto N\)). L'énergie libre par site, par exemple, converge vers la même valeur quelle que soit la condition aux bords.
Normes
L'utilisation de \(Z_N = \operatorname{Tr}(T^N)\) pour les systèmes 1D périodiques est une technique standard en mécanique statistique.
Formule(s)
La relation clé est :
En utilisant le résultat de l'algèbre linéaire \(\operatorname{Tr}(T^N) = \sum_i \lambda_i^N\), où \(\lambda_i\) sont les valeurs propres de T, on obtient :
Il suffit ensuite de remplacer \(\lambda_1\) et \(\lambda_2\) par leurs expressions.
Hypothèses
L'utilisation de la formule \(Z_N = \operatorname{Tr}(T^N)\) suppose explicitement des conditions aux bords périodiques. On maintient l'hypothèse \(H=0\).
- Conditions aux bords périodiques (\(s_{N+1} \equiv s_1\)).
- Champ magnétique nul (\(H=0\)).
Donnée(s)
Les valeurs propres \(\lambda_1 = 2 \cosh(\beta J)\) et \(\lambda_2 = 2 \sinh(\beta J)\) calculées précédemment.
Astuces
Pour l'analyse du comportement à \(N\) grand (limite thermodynamique), rappelez-vous que si \(|\lambda_1| > |\lambda_2|\), alors \(\lambda_1^N + \lambda_2^N = \lambda_1^N (1 + (\lambda_2/\lambda_1)^N)\). Comme \(|\lambda_2/\lambda_1| < 1\), le terme \((\lambda_2/\lambda_1)^N\) tend vers zéro exponentiellement vite quand \(N \to \infty\). C'est pourquoi \(Z_N \approx \lambda_1^N\) est une excellente approximation pour N grand.
Schéma (Avant les calculs)
La condition périodique signifie que la chaîne forme une boucle, le N-ième spin interagissant avec le premier.
Chaîne d'Ising N spins (périodique)
Calcul(s)
On applique la formule \(Z_N = \lambda_1^N + \lambda_2^N\) avec les valeurs propres trouvées.
Limite thermodynamique (\(N \to \infty\))
Comme \(\lambda_1 = 2 \cosh(\beta J)\) est strictement supérieure à \(|\lambda_2| = |2 \sinh(\beta J)|\) pour \(J \neq 0\) et \(T \neq \infty\), le premier terme domine exponentiellement.
Puisque \(|\tanh(\beta J)| < 1\) (pour \(T > 0\)), le terme \((\tanh(\beta J))^N \to 0\) lorsque \(N \to \infty\).
Schéma (Après les calculs)
Le résultat est une formule mathématique, pas un schéma.
Réflexions
L'expression exacte \(Z_N = \lambda_1^N + \lambda_2^N\) est déjà une simplification énorme par rapport à la somme initiale sur \(2^N\) termes. L'approximation \(Z_N \approx \lambda_1^N\) pour N grand est encore plus simple et suffisante pour calculer les grandeurs thermodynamiques intensives (par site), car elles dépendent de \(\ln Z_N / N \approx \ln \lambda_1\). Cette approximation capture l'essentiel de la physique à l'échelle macroscopique.
Points de vigilance
Bien distinguer l'expression exacte de \(Z_N\) (somme de deux termes) de son approximation pour \(N\) grand (un seul terme). L'approximation est utilisée pour calculer les grandeurs thermodynamiques intensives comme l'énergie libre par spin \(f = F/N = -k_B T \ln(\lambda_1)\), l'énergie par spin \(u\), etc. Si l'on s'intéressait à des effets de taille finie, il faudrait garder l'expression exacte.
Points à retenir
- La fonction de partition d'une chaîne 1D périodique est donnée par la trace \(Z_N = \operatorname{Tr}(T^N) = \sum_i \lambda_i^N\).
- Pour le modèle d'Ising 1D (H=0), \(Z_N = (2 \cosh(\beta J))^N + (2 \sinh(\beta J))^N\).
- Dans la limite thermodynamique (\(N \to \infty\)), \(Z_N\) est dominée par la plus grande valeur propre : \(Z_N \approx (2 \cosh(\beta J))^N\).
Le saviez-vous ?
Cette méthode de la matrice de transfert et l'approximation par la plus grande valeur propre sont très générales pour les systèmes 1D à courte portée. Elles sont utilisées pour étudier non seulement les chaînes de spins, mais aussi des modèles de polymères, de files d'attente, ou même des séquences génétiques.
FAQ
Questions sur l'expression de \(Z_N\).
Résultat Final
A vous de jouer
En utilisant l'approximation \(Z_N \approx \lambda_1^N\), calculez l'énergie libre par spin \(f = F/N = (-1/\beta N) \ln Z_N\). Exprimez le résultat en fonction de \(\lambda_1\).
Mini Fiche Mémo
Synthèse Q4 :
- Concept Clé : Connexion entre \(Z_N\), Trace et valeurs propres : \(Z_N = \operatorname{Tr}(T^N) = \sum_i \lambda_i^N\).
- Approximation (\(N \to \infty\)): \(Z_N \approx \lambda_{\text{max}}^N\).
- Résultat (Ising 1D, H=0) : \(\ln Z_N \approx N \ln(2 \cosh(\beta J))\).
Question 5 : Calculer l'énergie moyenne par spin \(u = U/N\).
Principe
L'énergie interne moyenne \(U\) du système est une grandeur thermodynamique fondamentale. Elle peut être calculée directement à partir de la fonction de partition \(Z\) via la relation \(U = -\frac{\partial (\ln Z)}{\partial \beta}\). Comme nous nous intéressons à la limite thermodynamique (\(N \to \infty\)), il est plus pertinent de calculer l'énergie moyenne par spin, \(u = U/N\). En utilisant l'approximation \( \ln Z_N \approx N \ln \lambda_1 \) dérivée à la question précédente, le calcul de \(u\) se simplifie considérablement, ne dépendant que de la dérivée du logarithme de la plus grande valeur propre \(\lambda_1\).
Mini-Cours
La relation \(U = -\frac{\partial (\ln Z)}{\partial \beta}\) est une pierre angulaire de la thermodynamique statistique dans l'ensemble canonique. Elle découle de la définition de la moyenne statistique de l'énergie \(\langle E \rangle = \sum_i E_i P_i = \sum_i E_i e^{-\beta E_i} / Z\). En remarquant que \(E_i e^{-\beta E_i} = -\frac{\partial}{\partial \beta} (e^{-\beta E_i})\), on peut réécrire la somme comme \(U = (1/Z) (-\frac{\partial}{\partial \beta} \sum_i e^{-\beta E_i}) = (-1/Z) \frac{\partial Z}{\partial \beta} = -\frac{\partial (\ln Z)}{\partial \beta}\). Cette relation montre comment l'énergie moyenne est directement liée à la dépendance de la fonction de partition par rapport à la température (\(\beta\)).
Remarque Pédagogique
Le passage au logarithme de \(Z\) est très fréquent. \(F = -k_B T \ln Z\) est l'énergie libre, un potentiel thermodynamique. Les dérivées de \(\ln Z\) (ou de \(F\)) par rapport aux variables appropriées (\(\beta\), \(H\), volume, etc.) donnent les grandeurs thermodynamiques moyennes correspondantes (énergie \(U\), magnétisation \(M\), pression \(P\), etc.). De plus, \(\ln Z\) est extensif (\(\propto N\)), donc \(\ln Z / N\) converge vers une quantité finie (l'énergie libre par site \(f\)) dans la limite \(N \to \infty\), ce qui est physiquement pertinent.
Normes
La formule \(U = -\frac{\partial (\ln Z)}{\partial \beta}\) est la définition standard de l'énergie interne moyenne dans l'ensemble canonique. Les règles de dérivation standard s'appliquent.
Formule(s)
Énergie moyenne totale \(U\)
Énergie moyenne par spin \(u\) (limite \(N \to \infty\))
On utilise \(\ln Z_N \approx N \ln \lambda_1\). La dérivée \(\partial/\partial \beta\) agit sur \(\ln \lambda_1\) et le facteur \(N\) se simplifie.
Il faut donc calculer la dérivée par rapport à \(\beta\) de \(\ln(2 \cosh(\beta J))\).
Hypothèses
L'approximation clé ici est l'utilisation de la limite thermodynamique (\(N \to \infty\)) qui permet de remplacer \(\ln Z_N\) par \(N \ln \lambda_1\). On travaille toujours sous l'hypothèse \(H=0\).
- Limite thermodynamique (\(N \to \infty\)).
- Champ magnétique nul (\(H=0\)).
Donnée(s)
L'expression de la plus grande valeur propre \(\lambda_1 = 2 \cosh(\beta J)\).
Astuces
Utiliser la règle de dérivation du logarithme : \(\frac{d}{dx}(\ln(f(x))) = \frac{f'(x)}{f(x)}\). Ici, \(x=\beta\) et \(f(x) = 2 \cosh(\beta J)\). Attention à la règle de dérivation en chaîne pour \(\cosh(\beta J)\) : sa dérivée par rapport à \(\beta\) est \(J \sinh(\beta J)\).
Schéma (Avant les calculs)
Pas de schéma pertinent pour le calcul de la dérivée.
Calcul(s)
Étape 1 : Calcul de \(\ln \lambda_1\)
Comme \(\lambda_1 = 2 \cosh(\beta J)\).
Étape 2 : Dérivation de \(\ln \lambda_1\) par rapport à \(\beta\)
La dérivée de \(\ln 2\) est nulle. On utilise \(\frac{d}{d\beta}(\ln(\cosh(\beta J))) = \frac{1}{\cosh(\beta J)} \times \frac{d}{d\beta}(\cosh(\beta J))\).
Étape 3 : Calcul de \(u = -\frac{\partial (\ln \lambda_1)}{\partial \beta}\)
On ajoute simplement le signe moins.
Schéma (Après les calculs)
Le résultat \(u = -J \tanh(J/k_B T)\) peut être tracé en fonction de la température \(T\). La fonction \(\tanh(x)\) part de 0 à \(x=0\) (\(T=\infty\)) et tend vers 1 quand \(x \to \infty\) (\(T \to 0\)). Donc \(u(T)\) part de 0 à \(T=\infty\) et tend vers \(-J\) à \(T=0\).
Énergie moyenne par spin \(u(T)\) (pour H=0)
Réflexions
Le résultat \(u = -J \tanh(\beta J)\) montre comment l'énergie moyenne par spin dépend de la compétition entre l'interaction \(J\) qui tend à aligner les spins (\(u \to -J\) à \(T=0\)) et l'agitation thermique \(k_B T\) qui tend à les désordonner (\(u \to 0\) à \(T=\infty\)). La transition entre ces deux régimes est douce et progressive, décrite par la fonction tangente hyperbolique.
Crucialement, la fonction \(u(T)\) et toutes ses dérivées (comme la capacité calorifique \(c_v = \partial u / \partial T = J^2/(k_B T^2 \cosh^2(J/k_B T))\)) sont continues et finies pour toute température \(T > 0\). Il n'y a aucune singularité, aucune "cassure" ou divergence. En thermodynamique statistique, les transitions de phase (comme l'apparition soudaine d'une aimantation spontanée en dessous d'une température critique \(T_c\)) sont associées à des non-analyticitiés dans l'énergie libre ou ses dérivées. L'absence de telles singularités ici est la preuve mathématique qu'il n'y a pas de transition de phase ferromagnétique à température finie (\(T_c > 0\)) dans le modèle d'Ising 1D. L'ordre ne peut exister qu'à \(T=0\) K.
Points de vigilance
Vérifier attentivement les dérivées, en particulier l'application de la règle de chaîne pour \(\cosh(\beta J)\) où la dérivée par rapport à \(\beta\) fait sortir un facteur \(J\). Ne pas oublier le signe "-" provenant de la définition de \(U\). Bien interpréter les limites \(T \to 0 \implies \beta \to \infty\) et \(T \to \infty \implies \beta \to 0\).
Points à retenir
- L'énergie moyenne par spin pour le modèle d'Ising 1D (H=0) est \(u = -J \tanh(\beta J) = -J \tanh(J/k_B T)\).
- Cette énergie varie de manière continue entre \(-J\) (état fondamental ordonné à \(T=0\)) et \(0\) (état désordonné à \(T=\infty\)).
- La régularité (analyticité) de \(u(T)\) et de ses dérivées pour \(T > 0\) démontre l'absence de transition de phase à température finie en 1D. La température critique est \(T_c = 0\).
Le saviez-vous ?
L'absence de transition de phase à \(T>0\) pour les systèmes 1D avec interactions à courte portée est un résultat assez général (théorème de Mermin-Wagner pour les symétries continues, argument de Landau-Peierls pour les systèmes discrets). Intuitivement, en 1D, une excitation de basse énergie (comme retourner un groupe de spins) suffit à détruire l'ordre à longue distance. En dimension supérieure (2D, 3D), de telles excitations coûtent plus d'énergie, ce qui permet à l'ordre de survivre jusqu'à une température critique \(T_c > 0\).
FAQ
Questions sur l'absence de transition de phase.
Résultat Final
A vous de jouer
La capacité calorifique par spin est \(c_v = \partial u / \partial T\). En utilisant \(u = -J \tanh(J/k_B T)\) et la règle de chaîne \(\partial/\partial T = (\partial \beta / \partial T) (\partial/\partial \beta) = (-1/k_B T^2) (\partial/\partial \beta)\), déterminez le signe de \(c_v\). Est-ce physiquement attendu ?
Mini Fiche Mémo
Synthèse Q5 :
- Formule Clé : \(u = -\frac{\partial (\ln \lambda_1)}{\partial \beta}\) pour \(N \to \infty\).
- Résultat (H=0) : \(u = -J \tanh(\beta J)\).
- Concept Important : La régularité de \(u(T)\) pour \(T>0\) implique \(T_c = 0\) (pas de transition de phase ferromagnétique à \(T>0\) en 1D).
Outil Interactif : Simulateur 1D (avec Champ \(H\))
L'exercice a été résolu pour \(H=0\). Mais que se passe-t-il si on applique un champ magnétique \(H \neq 0\) ? La magnétisation n'est plus nulle. Utilisez ce simulateur pour explorer la magnétisation moyenne par spin \(m(T, H)\) en fonction de la température et du champ.
Paramètres d'Entrée
Résultats Clés
Quiz Final : Testez vos connaissances
1. Qu'est-ce que l'Hamiltonien \(\mathcal{H}\) d'un système physique représente ?
2. Dans le modèle d'Ising, un couplage \(J > 0\) (ferromagnétique) signifie que l'énergie est plus basse lorsque :
3. Quelle est la conséquence principale de l'absence de transition de phase à \(T>0\) pour le modèle d'Ising 1D ?
4. La fonction de partition \(Z_N\) pour une chaîne 1D périodique est donnée par \(Z_N = \operatorname{Tr}(T^N)\). Comment cette expression se simplifie-t-elle dans la limite \(N \to \infty\) ?
5. Le calcul de l'énergie moyenne par spin \(u = -J \tanh(\beta J)\) montre que lorsque la température augmente (\(T \to \infty\)), l'énergie tend vers :
Glossaire
- Hamiltonien (\(\mathcal{H}\))
- En mécanique statistique, fonction qui représente l'énergie totale d'une configuration donnée (micro-état) du système.
- Fonction de Partition (\(Z\))
- Somme sur tous les micro-états possibles des poids statistiques de Boltzmann (\(e^{-\beta E}\)). Elle est la quantité centrale pour calculer toutes les propriétés thermodynamiques moyennes du système à l'équilibre.
- Magnétisation (\(M\))
- Aimantation macroscopique totale du matériau, résultant de la somme (moyennée statistiquement) de tous les moments magnétiques microscopiques (spins).
- Matrice de Transfert (\(T\))
- Outil mathématique spécifique aux systèmes 1D (ou quasi-1D) qui permet de calculer la fonction de partition \(Z_N\) en transformant la somme sur \(N\) variables en un produit de matrices, souvent simplifié par \(\operatorname{Tr}(T^N)\) ou \(\lambda_{\text{max}}^N\).
- Température Critique (\(T_c\))
- Température spécifique à laquelle un système subit une transition de phase (par exemple, passage de l'état paramagnétique à ferromagnétique). En dessous de \(T_c\), le système peut présenter un ordre spontané (ex: aimantation non nulle même sans champ externe). Pour le modèle d'Ising 1D, \(T_c = 0\).
- Ferromagnétisme
- Phénomène observé dans certains matériaux où les moments magnétiques atomiques s'alignent spontanément en dessous d'une certaine température (la température de Curie, \(T_c\)), créant une aimantation macroscopique permanente.
- Modèle d'Ising
- Modèle théorique simplifié en physique statistique où des variables binaires (spins \(\pm 1\)) sont placées sur un réseau et interagissent avec leurs voisins. Malgré sa simplicité, il capture l'essence des transitions de phase et de l'ordre collectif.
- Limite Thermodynamique
- Limite mathématique où la taille du système (\(N\)) et son volume (\(V\)) tendent vers l'infini, tout en gardant la densité (\(N/V\)) constante. Elle permet d'obtenir les propriétés macroscopiques intrinsèques, indépendantes des effets de surface ou de taille finie.
- \(\beta\)
- Paramètre thermodynamique représentant l'inverse de la température, multiplié par la constante de Boltzmann : \(\beta = 1 / (k_B T)\). Il apparaît naturellement dans le facteur de Boltzmann \(e^{-\beta E}\).
- Trace (\(\operatorname{Tr}\))
- Opération mathématique sur une matrice carrée consistant à sommer ses éléments diagonaux. Elle est égale à la somme des valeurs propres de la matrice.
D’autres exercices de Thermodynamique statistique:
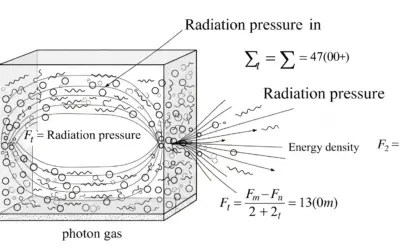
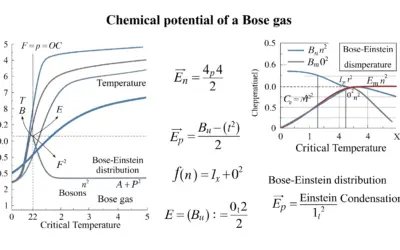
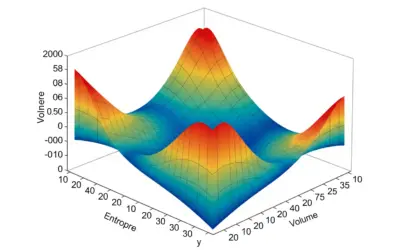

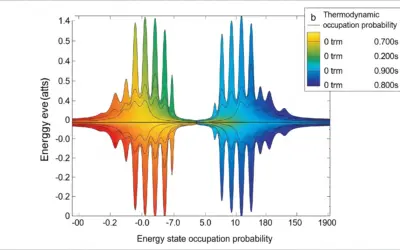
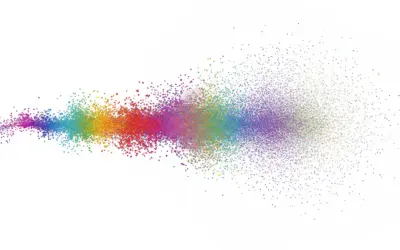
0 commentaires