Calcul de la Chaleur Échangée lors d'une Transformation Isobare
Contexte : La transformation isobareUne transformation thermodynamique qui s'effectue à pression constante..
En thermodynamique, l'étude des transformations de gaz est fondamentale pour comprendre le fonctionnement de nombreux systèmes, comme les moteurs thermiques ou les réfrigérateurs. Une transformation isobare, qui se produit à pression constante, est l'une des plus courantes. Cet exercice vous guidera dans le calcul des grandeurs énergétiques clés (travail, variation d'énergie interne et chaleur) pour un gaz parfaitUn modèle théorique de gaz où les interactions entre particules sont négligées, et qui suit la loi PV=nRT. subissant un échauffement à pression constante.
Remarque Pédagogique : Cet exercice vous apprendra à appliquer le Premier Principe de la ThermodynamiqueAussi appelé principe de conservation de l'énergie, il stipule que la variation d'énergie interne d'un système est égale à la somme du travail et de la chaleur échangés avec l'extérieur (ΔU = Q + W). dans un cas concret et à comprendre le rôle de l'enthalpieUne fonction d'état (H = U + PV) particulièrement utile pour les transformations isobares, car sa variation est égale à la chaleur échangée (ΔH = Qp)..
Objectifs Pédagogiques
- Définir et reconnaître une transformation isobare.
- Appliquer la loi des gaz parfaits pour déterminer les états d'un système.
- Calculer le travail des forces de pression, la variation d'énergie interne et la quantité de chaleur.
- Utiliser la fonction d'état enthalpie pour vérifier un calcul de chaleur.
Données de l'étude
Fiche Technique du Système
Schéma de la Transformation Isobare
| Paramètre | Description | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| P | Pression constante du gaz | 2 | bar |
| V₁ | Volume initial du gaz | 10 | L |
| T₁ | Température initiale du gaz | 300 | K |
| T₂ | Température finale du gaz | 450 | K |
| R | Constante des gaz parfaits | 8.314 | J·mol⁻¹·K⁻¹ |
| γ (gamma) | Coefficient de Laplace (N₂ est diatomique) | 1.4 | - |
Questions à traiter
- Calculer la quantité de matière (nombre de moles \(n\)) de diazote dans le cylindre.
- Déterminer le volume final \(V_2\) occupé par le gaz.
- Calculer le travail \(W_{1\to2}\) échangé par le gaz avec le milieu extérieur. Préciser s'il est reçu ou fourni par le système.
- Calculer la variation d'énergie interne \(\Delta U_{1\to2}\) du gaz.
- En déduire la quantité de chaleur \(Q_{1\to2}\) échangée. Vérifier ce résultat en utilisant l'enthalpie.
Les bases de la Thermodynamique
Pour résoudre cet exercice, plusieurs concepts fondamentaux de la thermodynamique des gaz parfaits sont nécessaires.
1. Le Premier Principe de la Thermodynamique
Il énonce la conservation de l'énergie pour un système. La variation de son énergie interne (\(\Delta U\)) est égale à la somme du travail (\(W\)) et de la chaleur (\(Q\)) échangés avec l'extérieur.
\[ \Delta U = Q + W \]
2. Loi des Gaz Parfaits
Elle décrit la relation entre la pression (P), le volume (V), la quantité de matière (n) et la température (T) d'un gaz parfait.
\[ PV = nRT \]
3. Enthalpie (H)
C'est une fonction d'état définie par \(H = U + PV\). Pour une transformation isobare, sa variation est égale à la chaleur échangée.
\[ \Delta H = Q_p \]
Correction : Chaleur Échangée lors d'une Transformation Isobare
Question 1 : Calculer la quantité de matière (n)
Principe
Pour trouver la quantité de gaz, on utilise la loi des gaz parfaits qui lie toutes les grandeurs d'état (P, V, T) à la quantité de matière (n). Il suffit d'appliquer cette loi à l'état initial (1), car nous connaissons toutes les informations nécessaires.
Mini-Cours
La loi des gaz parfaits, \(PV=nRT\), est une équation d'état qui modélise le comportement d'un gaz à basse pression. Elle relie ses variables macroscopiques : Pression (P), Volume (V), Température (T), et quantité de matière (n). La constante \(R\) est la constante universelle des gaz parfaits.
Remarque Pédagogique
En thermodynamique, la première étape est souvent de caractériser complètement l'état initial du système. Ici, P₁, V₁ et T₁ sont connus, la seule inconnue est donc \(n\). C'est un réflexe à avoir : si un état est presque entièrement décrit, utilisez une loi d'état pour trouver la grandeur manquante.
Normes
Les calculs scientifiques et techniques reposent sur le Système International d'unités (SI) pour garantir l'homogénéité et la validité des formules. L'utilisation de ces unités (Pascal pour la pression, m³ pour le volume, Kelvin pour la température) est une norme implicite pour toute application numérique en physique.
Formule(s)
Loi des gaz parfaits appliquée à l'état 1
Hypothèses
Le calcul repose sur une hypothèse fondamentale :
- Le diazote (N₂) se comporte comme un gaz parfait dans les conditions de l'expérience.
Donnée(s)
Nous extrayons les données de l'énoncé pour l'état 1.
| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| Pression | \(P_1\) | 2 | bar |
| Volume | \(V_1\) | 10 | L |
| Température | \(T_1\) | 300 | K |
| Constante | \(R\) | 8.314 | J·mol⁻¹·K⁻¹ |
Astuces
Avant de taper sur la calculatrice, vérifiez toujours la cohérence des unités. Si \(R\) est en J·mol⁻¹·K⁻¹, alors P doit être en Pa (N/m²) et V en m³ pour que le produit \(PV\) soit bien en Joules.
Schéma (Avant les calculs)
État Initial du Système
Calcul(s)
Conversion de la pression
Conversion du volume
Application numérique pour n
Schéma (Après les calculs)
Quantité de Matière
Réflexions
Le résultat, environ 0.8 mole, représente une quantité de matière concrète. Connaître \(n\) est crucial car c'est une quantité qui reste constante durant la transformation et qui sera nécessaire pour tous les calculs énergétiques ultérieurs.
Points de vigilance
L'erreur la plus commune est de ne pas utiliser les unités du Système International (SI) : la pression doit être en Pascals (Pa) et le volume en mètres cubes (m³).
Points à retenir
- La loi des gaz parfaits \(PV=nRT\) est l'outil principal pour décrire l'état d'un gaz.
- La conversion des unités (bar → Pa, L → m³) est une étape obligatoire et critique.
Le saviez-vous ?
La constante des gaz parfaits, \(R\), est parfois appelée constante de Boltzmann molaire. Elle est le produit de la constante de Boltzmann (\(k_B\)), qui s'applique à une seule particule, par le nombre d'Avogadro (\(N_A\)), qui est le nombre de particules dans une mole.
FAQ
Résultat Final
A vous de jouer
Si la pression initiale était de 3 bars dans les mêmes conditions de volume et température, quelle serait la nouvelle quantité de matière ?
Question 2 : Déterminer le volume final V₂
Principe
Puisque la transformation est isobare (pression constante) et que la quantité de matière \(n\) ne change pas, on peut utiliser la loi de Charles, une forme simplifiée de la loi des gaz parfaits, qui stipule que pour une masse de gaz donnée à pression constante, le volume est directement proportionnel à la température absolue (V/T = constante).
Mini-Cours
La loi de Charles (ou de Gay-Lussac pour les volumes) découle de \(PV=nRT\). Si P, n et R sont constants, alors \(V = (\frac{nR}{P})T\). Le terme entre parenthèses est une constante, donc \(V\) est proportionnel à \(T\). Cela implique que \(\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}\).
Remarque Pédagogique
Il est souvent plus rapide d'utiliser les lois simplifiées (Boyle-Mariotte, Charles, Gay-Lussac) quand les conditions le permettent. Reconnaître qu'une transformation est isobare, isochore ou isotherme vous fera gagner un temps précieux.
Normes
Pas de norme réglementaire spécifique ici, mais le principe de cohérence des unités s'applique. On doit utiliser la même unité pour \(V_1\) et \(V_2\), et une échelle de température absolue (Kelvin) pour \(T_1\) et \(T_2\).
Formule(s)
Loi de Charles
Hypothèses
Les hypothèses sont les mêmes que précédemment, avec l'ajout que la transformation est bien isobare.
- Le diazote se comporte comme un gaz parfait.
- La transformation entre l'état 1 et 2 se fait à pression constante.
Donnée(s)
| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| Volume initial | \(V_1\) | 10 | L |
| Température initiale | \(T_1\) | 300 | K |
| Température finale | \(T_2\) | 450 | K |
Astuces
Pour cette formule, qui est un rapport, tant que les volumes sont dans la même unité (ici, les Litres) et les températures en Kelvin, il n'est pas nécessaire de tout convertir en SI, ce qui simplifie le calcul.
Schéma (Avant les calculs)
Schéma de la Transformation Isobare
Calcul(s)
Calcul du volume final
Schéma (Après les calculs)
Diagramme Pression-Volume (Clapeyron)
Réflexions
Le gaz a été chauffé, il est donc logique que son volume ait augmenté (expansion thermique). Le résultat est cohérent.
Points de vigilance
L'erreur classique est d'oublier d'utiliser les températures en Kelvin. Si on utilisait les Celsius, le rapport ne serait pas correct et le résultat serait faux.
Points à retenir
- Pour une transformation isobare d'un gaz parfait, le volume est directement proportionnel à la température absolue.
- La loi de Charles (\(V_1/T_1 = V_2/T_2\)) est un outil puissant et rapide pour ces situations.
Le saviez-vous ?
Les montgolfières sont une application directe de la loi de Charles. En chauffant l'air à l'intérieur du ballon (augmentation de T), son volume tend à augmenter. Comme le ballon n'est pas infiniment extensible, une partie de l'air (et donc de la masse) s'échappe. À pression atmosphérique constante, l'air chaud à l'intérieur devient moins dense que l'air froid extérieur, créant la poussée d'Archimède qui fait s'élever le ballon.
FAQ
Résultat Final
A vous de jouer
Si on avait chauffé le gaz jusqu'à 600 K, quel aurait été le volume final en Litres ?
Question 3 : Calculer le travail W₁→₂
Principe
Le travail des forces de pression pour une transformation réversible est donné par l'intégrale de \(-P dV\). Dans le cas d'une transformation isobare, la pression P est constante et peut être sortie de l'intégrale, ce qui simplifie grandement le calcul. Le travail correspond géométriquement à l'aire (avec un signe négatif) sous la courbe de la transformation dans un diagramme P-V.
Mini-Cours
Le travail \(W\) représente un transfert d'énergie ordonné. Ici, c'est l'énergie transférée par le gaz au piston via la force de pression qui le déplace. Si le volume augmente (\(dV > 0\), expansion), le gaz pousse le piston et fournit du travail à l'extérieur (\(W < 0\)). Si le volume diminue (\(dV < 0\), compression), l'extérieur pousse le piston et fournit du travail au gaz (\(W > 0\)).
Remarque Pédagogique
Le signe du travail est une convention cruciale. En physique/chimie, on adopte souvent la convention "égoïste" : ce qui entre dans le système est positif, ce qui en sort est négatif. Comme le gaz fournit de l'énergie (il pousse), le travail sera négatif.
Normes
La convention de signe utilisée ici (\(W<0\) pour un travail fourni par le système) est celle recommandée par l'Union Internationale de Chimie Pure et Appliquée (IUPAC).
Formule(s)
Formule du travail isobare
Hypothèses
Le calcul est valable sous deux hypothèses :
- La transformation est isobare (Pression P constante).
- La transformation est réversible (ou quasi-statique), ce qui signifie que la pression interne du gaz \(P\) est à tout instant égale à la pression extérieure \(P_{\text{ext}}\).
Donnée(s)
| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| Pression constante | \(P\) | 2 | bar |
| Volume initial | \(V_1\) | 10 | L |
| Volume final | \(V_2\) | 15 | L |
Astuces
Visualisez le diagramme P-V. Pour une isobare, c'est un segment horizontal. Le travail est l'aire du rectangle sous ce segment. L'aire est \(P \times (V_2 - V_1)\). N'oubliez pas le signe "moins" de la formule !
Schéma (Avant les calculs)
Aire représentant le travail W
Calcul(s)
Conversions des unités en SI
Calcul du travail
Schéma (Après les calculs)
Travail Fourni par le Système
Réflexions
Le signe négatif confirme que le gaz a fourni de l'énergie au milieu extérieur en se détendant. Cette énergie de 1000 J a servi à "pousser l'atmosphère" via le piston.
Points de vigilance
Attention au signe ! La convention thermodynamique veut que le travail reçu par le système soit positif. Ici, le gaz se détend et pousse le piston : il fournit du travail au milieu extérieur, donc le travail échangé \(W\) doit être négatif. De plus, il faut utiliser les unités SI pour obtenir un résultat en Joules.
Points à retenir
- Le travail des forces de pression pour une transformation isobare réversible est \(W = -P \Delta V\).
- Un travail négatif signifie que le système a fourni de l'énergie au milieu extérieur (détente/expansion).
Le saviez-vous ?
Le diagramme Pression-Volume, utilisé ici, est aussi appelé diagramme de Clapeyron. Il est essentiel en ingénierie pour visualiser et calculer le travail produit par les cycles thermodynamiques des moteurs, comme le cycle de Beau de Rochas (moteur essence) ou le cycle Diesel.
FAQ
Résultat Final
A vous de jouer
Si le gaz avait été compressé de 15 L à 10 L à la même pression, quel aurait été le travail reçu par le gaz en Joules ?
Question 4 : Calculer la variation d'énergie interne ΔU₁→₂
Principe
Selon la première loi de Joule pour les gaz parfaits, la variation d'énergie interne ne dépend que de la variation de température. L'énergie interne représente l'énergie cinétique microscopique des molécules de gaz. Si la température augmente, cette agitation augmente, et donc l'énergie interne aussi.
Mini-Cours
La capacité thermique molaire à volume constant, \(C_v\), est la quantité d'énergie nécessaire pour élever la température d'une mole de gaz de 1 Kelvin, sans changer son volume. Pour un gaz parfait diatomique (comme N₂, avec 5 degrés de liberté : 3 en translation, 2 en rotation), la théorie cinétique des gaz donne \(C_v = \frac{5}{2}R\).
Remarque Pédagogique
C'est un point fondamental : peu importe le chemin suivi (isobare, isochore, etc.), si un gaz parfait passe de \(T_1\) à \(T_2\), sa variation d'énergie interne sera TOUJOURS \(\Delta U = n C_v (T_2 - T_1)\). L'énergie interne est une fonction d'état.
Normes
Pas de norme spécifique, mais l'utilisation des valeurs théoriques pour \(C_v\) (\(3/2 R\) pour monoatomique, \(5/2 R\) pour diatomique) est une convention standard en thermodynamique classique.
Formule(s)
Formule de la variation d'énergie interne
Hypothèses
Le calcul repose sur deux hypothèses :
- Le diazote est un gaz parfait.
- Sa capacité thermique \(C_v\) est constante sur l'intervalle de température [300 K, 450 K].
Donnée(s)
Nous utilisons la quantité de matière calculée précédemment, ainsi que les constantes et les températures définies dans l'énoncé.
| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| Quantité de matière | \(n\) | 0.802 | mol |
| Constante des gaz parfaits | \(R\) | 8.314 | J·mol⁻¹·K⁻¹ |
| Coefficient de Laplace | \(\gamma\) | 1.4 | - |
| Température initiale | \(T_1\) | 300 | K |
| Température finale | \(T_2\) | 450 | K |
Astuces
Vous pouvez aussi calculer \(C_v\) à partir du coefficient de Laplace \(\gamma\) via la relation \(C_v = \frac{R}{\gamma - 1}\). Pour \(\gamma=1.4\), on a \(C_v = \frac{R}{0.4} = \frac{5}{2}R\). C'est un bon moyen de vérifier.
Schéma (Avant les calculs)
Agitation Thermique Moléculaire
Calcul(s)
Calcul de la variation d'énergie interne
Schéma (Après les calculs)
Augmentation de l'Énergie Interne
Réflexions
La température a augmenté de 150 K, donc l'énergie interne du gaz (son agitation microscopique) a également augmenté. Le résultat positif de 2500 J est donc cohérent. C'est l'énergie "stockée" par le gaz sous forme d'agitation thermique.
Points de vigilance
L'erreur fréquente est d'utiliser la capacité thermique à pression constante (\(C_p\)) au lieu de celle à volume constant (\(C_v\)) pour calculer \(\Delta U\). L'énergie interne est toujours liée à \(C_v\).
Points à retenir
- La variation d'énergie interne d'un gaz parfait est toujours \(\Delta U = nC_v\Delta T\), quelle que soit la transformation.
- Pour un gaz diatomique, \(C_v = \frac{5}{2}R\).
Le saviez-vous ?
La première loi de Joule a été établie expérimentalement par James Prescott Joule avec sa célèbre expérience de la détente de Joule-Gay-Lussac. Il a montré qu'en laissant un gaz se détendre dans le vide (sans travail extérieur et sans échange de chaleur), sa température ne variait quasiment pas, prouvant que son énergie interne ne dépendait pas du volume.
FAQ
Résultat Final
A vous de jouer
Si le gaz était de l'argon (gaz monoatomique, \(C_v = \frac{3}{2}R\)), quelle aurait été la variation d'énergie interne pour la même transformation ?
Question 5 : Calculer la chaleur Q₁→₂
Principe
On peut trouver la chaleur de deux manières. D'abord en appliquant le Premier Principe, qui est un bilan énergétique : l'énergie apportée sous forme de chaleur (\(Q\)) doit servir à la fois à augmenter l'énergie interne du gaz (\(\Delta U\)) et à fournir le travail d'expansion (\(-W\)). Ensuite, pour vérifier, on peut la calculer directement en utilisant la notion d'enthalpie, qui est justement conçue pour simplifier les calculs de chaleur à pression constante.
Mini-Cours
L'enthalpie \(H = U + PV\) est une fonction d'état. Sa variation \(\Delta H = \Delta U + \Delta(PV)\). Pour une transformation isobare, \(P\) est constant, donc \(\Delta(PV) = P\Delta V\). Or, \(-P\Delta V = W\), donc \(\Delta H = \Delta U - W\). D'après le premier principe, \(Q = \Delta U - W\). On en déduit que pour une transformation isobare, \(Q_p = \Delta H\). On montre également que \(\Delta H = nC_p\Delta T\), où \(C_p\) est la capacité thermique à pression constante.
Remarque Pédagogique
Comparer les deux méthodes est un excellent moyen de vérifier vos calculs. Si \(Q = \Delta U - W\) ne donne pas le même résultat que \(Q = nC_p\Delta T\), il y a une erreur quelque part. L'enthalpie est "l'énergie" qu'il faut fournir à un système à pression constante pour augmenter sa température, en incluant le travail d'expansion.
Normes
Pas de norme spécifique, mais la relation de Mayer (\(C_p - C_v = R\)) est une relation fondamentale de la thermodynamique des gaz parfaits.
Formule(s)
Méthode 1 : Premier Principe
Méthode 2 : Enthalpie (Vérification)
Hypothèses
Les mêmes hypothèses que précédemment s'appliquent : gaz parfait et transformation isobare réversible.
Donnée(s)
Pour la vérification par la méthode de l'enthalpie, nous utilisons les données de base de l'exercice.
| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| Quantité de matière | \(n\) | 0.802 | mol |
| Constante des gaz parfaits | \(R\) | 8.314 | J·mol⁻¹·K⁻¹ |
| Coefficient de Laplace | \(\gamma\) | 1.4 | - |
| Température initiale | \(T_1\) | 300 | K |
| Température finale | \(T_2\) | 450 | K |
Astuces
Pour un chauffage isobare avec expansion, on doit fournir plus de chaleur que pour un chauffage isochore (à volume constant) pour obtenir la même élévation de température, car une partie de l'énergie (la chaleur) "s'échappe" sous forme de travail. C'est pourquoi \(C_p\) est toujours supérieur à \(C_v\).
Schéma (Avant les calculs)
Transfert de Chaleur vers le Système
Calcul(s)
Calcul par le Premier Principe (en utilisant les résultats précédents)
Vérification avec la capacité thermique
Application numérique
Schéma (Après les calculs)
Bilan Énergétique (Premier Principe)
Réflexions
Les deux méthodes donnent le même résultat, ce qui valide l'ensemble de nos calculs. La chaleur de 3500 J fournie au système a servi à deux choses : 2500 J ont été stockés pour augmenter l'énergie interne (température), et 1000 J ont été immédiatement utilisés pour fournir du travail au milieu extérieur.
Points de vigilance
Attention à ne pas confondre \(Q\) et \(\Delta U\). Dans le langage courant, on parle de "chaleur" pour parler de la température. En thermodynamique, la chaleur \(Q\) est un transfert d'énergie, alors que la variation d'énergie interne \(\Delta U\) est une variation de l'énergie stockée par le système.
Points à retenir
- Le Premier Principe \(\Delta U = Q + W\) est un bilan d'énergie.
- Pour une transformation isobare, la chaleur échangée est \(Q_p = \Delta H = nC_p\Delta T\).
Le saviez-vous ?
Le mot "enthalpie" a été inventé par le physicien néerlandais Heike Kamerlingh Onnes. Il vient du grec "enthalpos" (ἐνθάλπος), qui signifie "mettre de la chaleur à l'intérieur".
FAQ
Résultat Final
A vous de jouer
En utilisant la méthode de l'enthalpie, calculez la chaleur reçue si la température finale n'était que de 350 K.
Outil Interactif : Simulateur de Chauffage Isobare
Utilisez les curseurs pour faire varier la température initiale et finale du gaz (en gardant P=2 bar et V₁=10 L) et observez l'impact sur les grandeurs énergétiques.
Paramètres d'Entrée
Résultats Clés
Quiz Final : Testez vos connaissances
1. Lors d'une expansion isobare d'un gaz parfait, le travail W est :
2. Pour une transformation à pression constante, la chaleur échangée Qp est égale à :
3. La variation d'énergie interne d'un gaz parfait dépend uniquement de :
4. Si on chauffe un gaz dans un cylindre à piston mobile, le volume final sera :
Glossaire
- Transformation Isobare
- Une transformation thermodynamique au cours de laquelle la pression du système reste constante.
- Premier Principe de la Thermodynamique
- Principe de conservation de l'énergie appliqué à la thermodynamique. Il s'énonce : \(\Delta U = Q + W\).
- Enthalpie (H)
- Une grandeur physique, fonction d'état, définie par \(H = U + PV\). Sa variation lors d'une transformation isobare est égale à la chaleur échangée : \(\Delta H = Q_p\).
- Gaz Parfait
- Un modèle idéal de gaz dans lequel les particules sont considérées comme ponctuelles et n'interagissent pas entre elles, sauf par des collisions élastiques. Il obéit à la loi \(PV = nRT\).
D’autres exercices Thermodynamique Classique:
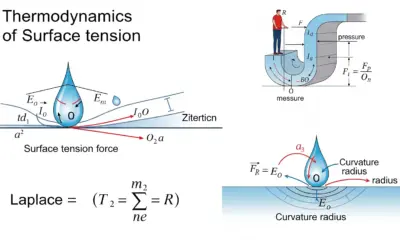
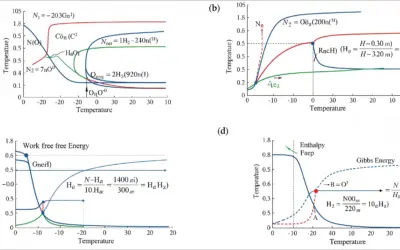
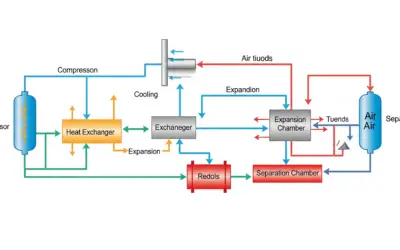
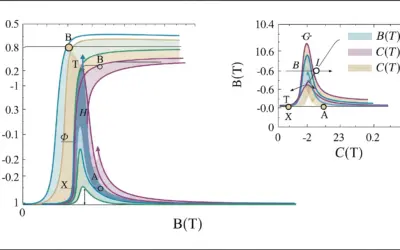
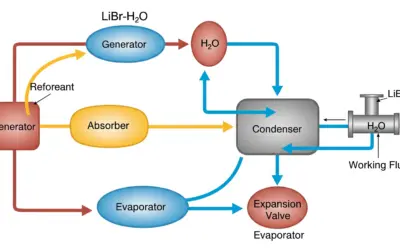
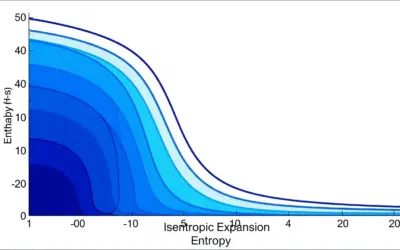
0 commentaires