Thermodynamique d’une Pile et Relation de Nernst
Contexte : La pile DaniellUne pile électrochimique classique composée d'une électrode de zinc plongeant dans une solution de sulfate de zinc, et d'une électrode de cuivre dans une solution de sulfate de cuivre, reliées par un pont salin..
L'étude des piles électrochimiques est un pilier de la thermodynamique chimique. Elle permet de comprendre comment l'énergie chimique stockée dans les réactifs peut être convertie en énergie électrique. La pile Daniell (zinc-cuivre) est un exemple canonique qui illustre les principes de l'oxydo-réduction, du potentiel d'électrodeLa mesure de la tendance d'une demi-cellule à gagner ou à perdre des électrons. Il est mesuré en volts (V). et de la spontanéité des réactions. Cet exercice vise à calculer la force électromotrice (f.é.m.) de cette pile dans des conditions non standards en utilisant la célèbre relation de Nernst.
Remarque Pédagogique : Cet exercice vous apprendra à relier les concepts thermodynamiques (spontanéité, potentiel) aux conditions expérimentales (concentrations des réactifs), une compétence essentielle en chimie et en ingénierie.
Objectifs Pédagogiques
- Comprendre le fonctionnement d'une pile électrochimique (anode, cathode, circulation des électrons).
- Savoir calculer la force électromotrice standard (\(E^0_{\text{pile}}\)) à partir des potentiels standards de réduction.
- Maîtriser l'application de la relation de Nernst pour déterminer la f.é.m. dans des conditions réelles.
Données de l'étude
Schéma de la Pile Daniell
| Paramètre | Description ou Formule | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| \(E^0(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu})\) | Potentiel standard de réduction du couple Cuivre | +0.34 | V |
| \(E^0(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn})\) | Potentiel standard de réduction du couple Zinc | -0.76 | V |
| \([\text{Cu}^{2+}]\) | Concentration initiale en ions cuivre II | 0.5 | mol/L |
| \([\text{Zn}^{2+}]\) | Concentration initiale en ions zinc II | 1.5 | mol/L |
| R | Constante des gaz parfaits | 8.314 | J·mol⁻¹·K⁻¹ |
| F | Constante de Faraday | 96485 | C·mol⁻¹ |
Questions à traiter
- Écrire les demi-réactions se produisant à chaque électrode, puis en déduire la réaction globale de la pile.
- Identifier l'anode (siège de l'oxydation) et la cathode (siège de la réduction). Justifier.
- Calculer la force électromotrice (f.é.m.) standard \(E^0_{\text{pile}}\) de cette pile.
- Calculer la valeur du quotient réactionnel, Q, dans les conditions initiales données.
- En utilisant la relation de Nernst, calculer la f.é.m. initiale de la pile, \(E_{\text{pile}}\), dans ces conditions non standards.
Les bases sur l'Électrochimie
Pour qu'une pile fonctionne, une réaction d'oxydo-réduction spontanée doit avoir lieu. Cette réaction est séparée en deux demi-réactions dans deux compartiments distincts, les demi-piles. Le transfert d'électrons se fait via un circuit externe, générant un courant électrique.
1. Force Électromotrice Standard (\(E^0_{\text{pile}}\))
La f.é.m. standard d'une pile est la différence de potentiel entre la cathode et l'anode dans les conditions standards (concentrations de 1 mol/L, pression de 1 bar, T = 298 K). Elle se calcule à partir des potentiels standards de réduction (\(E^0\)) de chaque couple. La réaction est spontanée si \(E^0_{\text{pile}} > 0\).
\[ E^0_{\text{pile}} = E^0_{\text{cathode}} - E^0_{\text{anode}} \]
2. Relation de Nernst
Lorsque les conditions ne sont pas standards, la f.é.m. de la pile (\(E_{\text{pile}}\)) dépend des concentrations des espèces électroactives. La relation de Nernst quantifie cet écart par rapport au potentiel standard.
\[ E_{\text{pile}} = E^0_{\text{pile}} - \frac{RT}{nF} \ln(Q) \]
Où R est la constante des gaz parfaits, T la température en Kelvin, n le nombre d'électrons échangés dans la réaction, F la constante de Faraday, et Q le quotient réactionnel.
Correction : Thermodynamique d’une Pile et Relation de Nernst
Question 1 : Écriture des réactions
Principe (le concept physique)
Le cœur d'une pile est une réaction d'oxydo-réduction spontanée. Pour la comprendre, on la décompose en deux "demi-réactions" : une oxydation (perte d'électrons) et une réduction (gain d'électrons). Le but de cette question est d'identifier ces deux processus et de les combiner pour obtenir l'équation qui décrit le fonctionnement global de la pile.
Mini-Cours (approfondissement théorique)
En électrochimie, on compare la tendance des couples rédox à capter des électrons grâce à leur potentiel de réduction standard (\(E^0\)). Le couple avec le \(E^0\) le plus élevé est le meilleur accepteur d'électrons : son oxydant subira la réduction. À l'inverse, le couple avec le \(E^0\) le plus faible a la plus grande tendance à céder des électrons : son réducteur subira l'oxydation. Pour obtenir la réaction d'oxydation, on "inverse" la demi-réaction de réduction du couple concerné.
Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)
Une méthode infaillible : 1. Identifiez le couple avec le potentiel le plus haut (ce sera la cathode/réduction). 2. Recopiez sa demi-réaction telle quelle. 3. Identifiez le couple avec le potentiel le plus bas (l'anode/oxydation). 4. Écrivez sa demi-réaction "à l'envers". 5. Assurez-vous que le nombre d'électrons est le même des deux côtés, puis additionnez les deux équations.
Normes (la référence réglementaire)
La convention de l'IUPAC veut que les demi-réactions soient toujours écrites dans le sens de la réduction (Oxydant + n e⁻ → Réducteur) dans les tables de potentiels standards. C'est à nous, en fonction du contexte de la pile, d'inverser celle qui correspond à l'oxydation.
Formule(s) (l'outil mathématique)
Construction de la réaction globale
Hypothèses (le cadre du calcul)
On suppose que la réaction qui se produit spontanément est celle qui implique le couple au potentiel le plus élevé comme siège de la réduction, et celui au potentiel le plus faible comme siège de l'oxydation. On suppose aussi que le nombre d'électrons perdus à l'anode est égal au nombre d'électrons gagnés à la cathode.
Donnée(s) (les chiffres d'entrée)
| Couple Rédox | Demi-réaction de réduction | Potentiel Standard (\(E^0\)) |
|---|---|---|
| \(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}\) | \(\text{Cu}^{2+}_{\text{aq}} + 2e^- \rightarrow \text{Cu}_{\text{s}}\) | +0.34 V |
| \(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}\) | \(\text{Zn}^{2+}_{\text{aq}} + 2e^- \rightarrow \text{Zn}_{\text{s}}\) | -0.76 V |
Astuces (Pour aller plus vite)
Utilisez la "règle du gamma" (γ) : sur un axe de potentiel, la réaction spontanée se produit entre l'oxydant le plus fort (le plus haut sur l'axe) et le réducteur le plus fort (le plus bas sur l'axe). Tracez un "gamma" partant de l'oxydant du couple supérieur vers son réducteur, puis vers le réducteur du couple inférieur et enfin son oxydant. Cela vous donne directement le sens de la réaction.
Schéma (Avant les calculs)
Identification via la "Règle du Gamma"
Calcul(s) (l'application numérique)
Demi-réaction de Réduction (Cathode)
Demi-réaction d'Oxydation (Anode)
Somme pour la Réaction Globale
On additionne les deux demi-réactions. Les électrons, présents en nombre égal de chaque côté, s'annulent mutuellement.
Schéma (Après les calculs)
Schéma de la Pile Daniell
Réflexions (l'interprétation du résultat)
L'équation globale \(\text{Zn}_{\text{s}} + \text{Cu}^{2+}_{\text{aq}} \rightarrow \text{Zn}^{2+}_{\text{aq}} + \text{Cu}_{\text{s}}\) montre un transfert de matière : du zinc solide se transforme en ions zinc en solution, tandis que des ions cuivre en solution se transforment en cuivre solide. C'est cette transformation de matière qui libère l'énergie convertie en électricité.
Points de vigilance (les erreurs à éviter)
Équilibre de la matière : Assurez-vous que le nombre de chaque atome est le même de chaque côté de la flèche.
Équilibre des charges : La charge électrique totale doit aussi être la même de chaque côté. Ici (0) + (+2) = (+2) + (0), c'est équilibré.
Nombre d'électrons : Avant de sommer, multipliez les demi-réactions si nécessaire pour que le nombre d'électrons échangés soit identique.
Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)
- Le couple avec le \(E^0\) le plus haut subit la réduction.
- Le couple avec le \(E^0\) le plus bas subit l'oxydation (on inverse sa demi-réaction).
- On doit équilibrer les électrons avant de sommer les deux demi-réactions.
Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)
La pile Daniell a été inventée en 1836 par le chimiste britannique John Frederic Daniell. C'était une amélioration majeure par rapport à la pile de Volta car sa tension était beaucoup plus stable dans le temps, ce qui a permis les premiers développements du télégraphe électrique.
FAQ (pour lever les doutes)
Résultat Final (la conclusion chiffrée)
A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)
Pour la pile \(\text{Ag}^{+}/\text{Ag}\) et \(\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}\) de la question 3, quelle est la réaction globale ? (Écrivez-la puis cliquez pour voir la réponse).
Question 2 : Identification de l'anode et de la cathode
Principe (le concept physique)
L'anode est le siège de l'oxydation (perte d'électrons), tandis que la cathode est le siège de la réduction (gain d'électrons). Pour identifier qui est qui, on compare les potentiels de réduction standard (\(E^0\)) des deux couples : le couple avec le potentiel le plus élevé subira la réduction.
Mini-Cours (approfondissement théorique)
Dans une pile (cellule galvanique), la réaction d'oxydo-réduction est spontanée. Les électrons libérés par l'oxydation à l'anode circulent vers la cathode pour y être consommés par la réduction. L'anode, source d'électrons, est la borne négative. La cathode, qui attire les électrons, est la borne positive. On peut retenir : Anode-Oxydation (deux voyelles) et Cathode-Réduction (deux consonnes).
Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)
La première étape est toujours de comparer les potentiels. Placez-les sur un axe vertical. Le couple le plus "haut" (potentiel le plus positif) sera la cathode. Le couple le plus "bas" sera l'anode.
Normes (la référence réglementaire)
La convention IUPAC définit l'anode comme le siège de l'oxydation et la cathode comme le siège de la réduction, quel que soit le type de cellule électrochimique (pile ou électrolyseur).
Formule(s) (l'outil mathématique)
Règle de comparaison
Hypothèses (le cadre du calcul)
On se base sur les potentiels *standards* pour déterminer le sens spontané de la réaction. On suppose que la pile fonctionne en générateur (débit de courant).
Donnée(s) (les chiffres d'entrée)
| Paramètre | Description | Valeur |
|---|---|---|
| \(E^0(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu})\) | Potentiel standard du couple Cuivre | +0.34 V |
| \(E^0(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn})\) | Potentiel standard du couple Zinc | -0.76 V |
Astuces (Pour aller plus vite)
Le moyen mnémotechnique "Le plus fort oxyde le plus faible" peut être trompeur. Préférez "L'oxydant du couple au potentiel le plus élevé réagit avec le réducteur du couple au potentiel le plus faible".
Schéma (Avant les calculs)
Comparaison des Potentiels Standards
Calcul(s) (l'application numérique)
Comparaison des potentiels
Puisque le couple Cuivre a le potentiel le plus élevé, il subit la réduction (cathode). Le couple Zinc, ayant le potentiel le plus faible, subit l'oxydation (anode).
Schéma (Après les calculs)
Identification des Électrodes
Réflexions (l'interprétation du résultat)
L'identification de l'anode et de la cathode est cruciale. Elle détermine le sens de circulation des électrons (de l'anode vers la cathode) et des ions dans le pont salin (anions vers l'anode, cations vers la cathode), et conditionne tous les calculs de potentiel qui suivent.
Points de vigilance (les erreurs à éviter)
Ne pas confondre une pile (générateur) avec un électrolyseur (récepteur). Dans un électrolyseur, les polarités sont inversées : l'anode est la borne (+) et la cathode la borne (-), car la réaction est forcée par un générateur extérieur.
Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)
- Cathode = Réduction = Couple au \(E^0\) le plus élevé = Borne (+).
- Anode = Oxydation = Couple au \(E^0\) le plus bas = Borne (-).
Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)
Les termes "anode" et "cathode" ont été créés par Michael Faraday. "Anode" vient du grec *anodos* (montée) et "cathode" de *kathodos* (descente), décrivant le chemin du courant tel qu'il était conçu à l'époque.
FAQ (pour lever les doutes)
Résultat Final (la conclusion chiffrée)
A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)
Pour la pile \(\text{Ag}^{+}/\text{Ag}\) (\(E^0 = +0.80\) V) et \(\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}\) (\(E^0 = -0.25\) V), quelle est la cathode ?
Question 3 : Calcul de la f.é.m. standard (\(E^0_{\text{pile}}\))
Principe (le concept physique)
Le principe est de quantifier la "force" avec laquelle les électrons sont poussés de l'anode vers la cathode. Cette force, appelée force électromotrice (f.é.m.), est une différence de potentiel. En conditions standards, cette valeur est fixe et dépend uniquement de la nature chimique des deux couples rédox impliqués.
Mini-Cours (approfondissement théorique)
Chaque couple rédox (ex: \(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}\)) possède un potentiel de réduction standard (\(E^0\)) qui mesure sa tendance à capter des électrons. Plus \(E^0\) est élevé, plus l'oxydant du couple est "fort". La f.é.m. standard de la pile, \(E^0_{\text{pile}}\), est la différence entre le potentiel du couple qui subit la réduction (cathode) et celui qui subit l'oxydation (anode). Une valeur positive de \(E^0_{\text{pile}}\) indique que la réaction globale est spontanée dans le sens direct.
Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)
La clé ici est de ne jamais se tromper dans l'identification de la cathode et de l'anode. Rappelez-vous toujours : la réduction se produit à la cathode, et c'est le couple avec le potentiel standard le plus élevé qui est réduit. L'erreur la plus commune est d'inverser les deux termes dans la soustraction.
Normes (la référence réglementaire)
Les potentiels standards de réduction sont des valeurs de référence établies par l'Union Internationale de Chimie Pure et Appliquée (IUPAC). Ils sont mesurés à 298 K (25°C), pour des concentrations de 1 mol/L et des pressions de 1 bar, par rapport à l'Électrode Standard à Hydrogène (ESH) dont le potentiel est défini comme étant 0 V.
Formule(s) (l'outil mathématique)
Définition de la f.é.m. standard
Hypothèses (le cadre du calcul)
Le calcul de la f.é.m. *standard* implique que nous nous plaçons dans les conditions standards de température (298 K), de pression (1 bar) et de concentration (1 mol/L pour toutes les espèces en solution), même si l'énoncé donne d'autres concentrations pour les questions suivantes.
Donnée(s) (les chiffres d'entrée)
| Paramètre | Description | Valeur |
|---|---|---|
| \(E^0(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu})\) | Potentiel standard de la cathode | +0.34 V |
| \(E^0(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn})\) | Potentiel standard de l'anode | -0.76 V |
Astuces (Pour aller plus vite)
Pour éviter les erreurs de signe, pensez à la f.é.m. comme à une "distance" sur un axe vertical des potentiels. La f.é.m. est l'écart entre le potentiel le plus haut (cathode) et le plus bas (anode). Le résultat doit toujours être positif pour une pile qui fonctionne spontanément.
Schéma (Avant les calculs)
Axe des Potentiels Standards
Calcul(s) (l'application numérique)
Calcul de la f.é.m. standard
Schéma (Après les calculs)
Lecture de la f.é.m. Standard
Réflexions (l'interprétation du résultat)
La valeur positive de \(E^0_{\text{pile}}\) (1.10 V) confirme que la réaction, telle qu'écrite, est spontanée dans les conditions standards. C'est cette spontanéité qui est le "moteur" de la pile, permettant la conversion d'énergie chimique en énergie électrique.
Points de vigilance (les erreurs à éviter)
L'erreur de signe : L'erreur la plus fréquente est de mal gérer le double signe négatif : \(0.34 - (-0.76)\).
Ne pas inverser les potentiels : On ne change jamais le signe des potentiels standards de réduction tirés des tables. La formule \(E^0_{\text{cathode}} - E^0_{\text{anode}}\) s'en charge.
Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)
- La f.é.m. standard est toujours \(E^0_{\text{cathode}} - E^0_{\text{anode}}\).
- La cathode est toujours le couple avec le \(E^0\) le plus élevé.
- Une f.é.m. positive signifie que la pile peut fonctionner spontanément.
Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)
L'unité de potentiel électrique, le Volt, est nommée en l'honneur d'Alessandro Volta, l'inventeur de la première pile électrique (la "pile voltaïque") en 1800. Sa pile était un empilement de disques de cuivre et de zinc séparés par du feutre imbibé d'eau salée.
FAQ (pour lever les doutes)
Résultat Final (la conclusion chiffrée)
A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)
Calculez la f.é.m. standard d'une pile constituée des couples \(\text{Ag}^{+}/\text{Ag}\) (\(E^0 = +0.80\) V) et \(\text{Ni}^{2+}/\text{Ni}\) (\(E^0 = -0.25\) V).
Question 4 : Calcul du quotient réactionnel (Q)
Principe (le concept physique)
Le quotient réactionnel (Q) est un "instantané" de la composition du système. Il compare les quantités de produits et de réactifs à un moment donné. Sa valeur nous indique si la réaction est aux conditions initiales, à l'équilibre, ou dans un état intermédiaire, et donc dans quel sens elle va évoluer spontanément.
Mini-Cours (approfondissement théorique)
Le quotient réactionnel est défini par le rapport du produit des activités des produits, élevées à leur coefficient stœchiométrique, au produit des activités des réactifs, également élevées à leur coefficient. Par convention, l'activité d'un solide pur ou d'un liquide pur (solvant) est égale à 1. Pour les espèces en solution diluée, l'activité est approximée par la concentration molaire (en mol/L).
Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)
L'erreur la plus courante est d'inclure les solides dans l'expression de Q. Rappelez-vous : les concentrations des solides (comme les électrodes de Cu et Zn) ne changent pas, leur activité est donc fixée à 1 et ils n'apparaissent pas dans la formule de Q.
Normes (la référence réglementaire)
L'utilisation des activités est la norme IUPAC. L'approximation par les concentrations molaires est valide pour les solutions idéales (généralement considérées comme telles pour des concentrations inférieures à 0.1 mol/L), mais reste une approximation couramment utilisée dans les exercices.
Formule(s) (l'outil mathématique)
Expression du quotient réactionnel
Hypothèses (le cadre du calcul)
On suppose que les solutions sont suffisamment diluées pour que l'activité des ions puisse être assimilée à leur concentration molaire. On considère que les électrodes de zinc et de cuivre sont des solides purs, leur activité est donc de 1.
Donnée(s) (les chiffres d'entrée)
| Paramètre | Description | Valeur |
|---|---|---|
| \([\text{Zn}^{2+}]\) | Concentration des produits en solution | 1.5 mol/L |
| \([\text{Cu}^{2+}]\) | Concentration des réactifs en solution | 0.5 mol/L |
Astuces (Pour aller plus vite)
Une astuce mnémotechnique simple : "les produits sur les réactifs". Il suffit d'identifier les produits et les réactifs de la réaction globale et de ne garder que les espèces en solution (aq) ou gazeuses (g).
Schéma (Avant les calculs)
Concentrations initiales dans la pile
Calcul(s) (l'application numérique)
Calcul du quotient réactionnel
Schéma (Après les calculs)
Rapport des concentrations initiales
Réflexions (l'interprétation du résultat)
Un quotient réactionnel Q = 3.0 signifie que, au départ, la concentration en produits (\([\text{Zn}^{2+}]\)) est trois fois supérieure à celle en réactifs (\([\text{Cu}^{2+}]\)). Le système est donc "plus riche en produits" que dans les conditions standards où Q serait égal à 1 (car \([\text{Zn}^{2+}] = [\text{Cu}^{2+}] = 1\) M). Cela suggère que la réaction sera un peu moins "poussée" vers la droite que dans les conditions standards.
Points de vigilance (les erreurs à éviter)
Inverser le rapport : Attention à ne pas mettre les réactifs au numérateur. C'est toujours [Produits]/[Réactifs].
Oublier les coefficients stœchiométriques : Dans cette réaction, tous les coefficients sont de 1, mais si la réaction était \(2\text{Ag}^{+} + \text{Cu} \rightarrow 2\text{Ag} + \text{Cu}^{2+}\), Q serait \([\text{Cu}^{2+}]/[\text{Ag}^{+}]^2\).
Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)
- L'expression de Q dépend de l'équation de la réaction globale.
- Les solides et les liquides purs (solvants) n'apparaissent pas dans Q (leur activité est 1).
- Q est un nombre sans dimension.
Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)
Le concept de quotient réactionnel est une extension de la loi d'action de masse, formulée par les chimistes norvégiens Guldberg et Waage en 1864. Leur travail a jeté les bases de notre compréhension moderne de l'équilibre chimique.
FAQ (pour lever les doutes)
Résultat Final (la conclusion chiffrée)
A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)
Calculez Q si les concentrations initiales étaient \([\text{Zn}^{2+}] = 0.1\) M et \([\text{Cu}^{2+}] = 1.8\) M.
Question 5 : Calcul de la f.é.m. non standard (\(E_{\text{pile}}\))
Principe (le concept physique)
Le potentiel d'une pile n'est pas constant ; il varie avec l'avancement de la réaction car les concentrations des réactifs et des produits changent. La relation de Nernst est l'outil fondamental qui permet de calculer la f.é.m. d'une pile à n'importe quel moment de son fonctionnement, en reliant son potentiel standard à la composition instantanée du système via le quotient réactionnel Q.
Mini-Cours (approfondissement théorique)
La relation de Nernst découle de la relation fondamentale de la thermodynamique \(\Delta G = \Delta G^0 + RT \ln(Q)\), où \(\Delta G\) est l'enthalpie libre de Gibbs. Sachant que l'énergie électrique fournie par la pile est liée à l'enthalpie libre par la relation \(\Delta G = -nFE_{\text{pile}}\) (et \(\Delta G^0 = -nFE^0_{\text{pile}}\)), une simple substitution et réarrangement de ces équations mène directement à la relation de Nernst. Elle montre comment l'écart d'énergie libre par rapport au standard se traduit en un écart de potentiel électrique.
Remarque Pédagogique (le conseil du professeur)
Plutôt que d'apprendre par cœur la formule complexe, comprenez sa logique : \(E_{\text{pile}}\) est le potentiel standard \(E^0_{\text{pile}}\) corrigé par un terme qui dépend de la composition (\(Q\)) et de la température. Si \(Q>1\) (plus de produits), le terme correctif est négatif et \(E_{\text{pile}} < E^0_{\text{pile}}\). Si \(Q<1\) (plus de réactifs), le terme \(\ln(Q)\) est négatif, le terme correctif devient positif, et \(E_{\text{pile}} > E^0_{\text{pile}}\).
Normes (la référence réglementaire)
La relation de Nernst est une équation fondamentale de l'électrochimie, universellement reconnue. Les valeurs des constantes R (constante des gaz parfaits) et F (constante de Faraday) sont des constantes physiques fondamentales définies internationalement.
Formule(s) (l'outil mathématique)
Relation de Nernst
Hypothèses (le cadre du calcul)
Nous effectuons le calcul à l'instant initial. Le nombre d'électrons échangés, n, est de 2 pour la réaction de la pile Daniell. La température est fixée à 298 K (25 °C), ce qui est une condition très courante dans les exercices.
Donnée(s) (les chiffres d'entrée)
| Paramètre | Symbole | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| F.é.m. standard | \(E^0_{\text{pile}}\) | 1.10 | V |
| Constante des gaz parfaits | R | 8.314 | J·mol⁻¹·K⁻¹ |
| Température | T | 298 | K |
| Nombre d'électrons | n | 2 | - |
| Constante de Faraday | F | 96485 | C·mol⁻¹ |
| Quotient Réactionnel | Q | 3.0 | - |
Astuces (Pour aller plus vite)
À 298 K, le terme \(\frac{RT}{F}\) vaut environ 0.0257 V. Si vous utilisez le logarithme décimal (log) au lieu du népérien (ln), le terme \(\frac{2.303 RT}{F}\) vaut environ 0.0592 V. La formule devient alors \(E_{\text{pile}} = E^0_{\text{pile}} - \frac{0.0592}{n} \log(Q)\). C'est une simplification très pratique pour les calculs rapides.
Schéma (Avant les calculs)
Pile en conditions non-standards
Calcul(s) (l'application numérique)
Remplacement des valeurs numériques
Calcul du terme pré-logarithmique
Calcul final de la f.é.m.
Schéma (Après les calculs)
Influence de Q sur la f.é.m. de la Pile
Réflexions (l'interprétation du résultat)
La f.é.m. calculée (1.086 V) est légèrement inférieure à la f.é.m. standard (1.10 V). Cela est logique car le quotient réactionnel initial Q=3 est supérieur à 1. La pile a déjà une concentration en produits relativement élevée, ce qui diminue sa "volonté" de réagir et donc son potentiel électrique, par rapport à la situation standard.
Points de vigilance (les erreurs à éviter)
Unités : Assurez-vous que R est en Joules et non en L·atm·mol⁻¹·K⁻¹. La température doit être en Kelvin.
Logarithme : Ne confondez pas le logarithme népérien (ln) et le logarithme décimal (log). La formule de base utilise ln.
Valeur de n : Identifiez toujours correctement le nombre d'électrons échangés dans la réaction globale équilibrée.
Points à retenir (permettre a l'apprenant de maitriser la question)
- La relation de Nernst permet de calculer la f.é.m. dans n'importe quelles conditions de concentration.
- \(E_{\text{pile}}\) diminue au fur et à mesure que la pile débite (Q augmente).
- Lorsque \(E_{\text{pile}} = 0\), la pile est à l'équilibre (elle est "usée"), et \(Q = K\) (constante d'équilibre).
Le saviez-vous ? (la culture de l'ingénieur)
Walther Nernst, qui a formulé cette équation, a reçu le prix Nobel de chimie en 1920 pour ses travaux en thermochimie. Sa découverte est fondamentale non seulement en électrochimie, mais aussi en biologie pour comprendre les potentiels de membrane des cellules nerveuses (neurones).
FAQ (pour lever les doutes)
Résultat Final (la conclusion chiffrée)
A vous de jouer (pour verifier la comprehension de l'etudiant parrapport a la question)
Calculez la f.é.m. si la concentration en \([\text{Cu}^{2+}]\) était de 2.0 mol/L et celle en \([\text{Zn}^{2+}]\) de 0.2 mol/L.
Outil Interactif : Simulateur de la Pile Daniell
Utilisez les curseurs ci-dessous pour faire varier les concentrations des ions \(\text{Zn}^{2+}\) et \(\text{Cu}^{2+}\) et observez en temps réel l'impact sur la force électromotrice (f.é.m.) de la pile, conformément à la relation de Nernst.
Paramètres d'Entrée
Résultats Clés
Quiz Final : Testez vos connaissances
1. Que se passe-t-il à l'anode d'une pile électrochimique ?
2. Quel est le rôle principal du pont salin dans une pile ?
3. Selon la relation de Nernst, si on augmente la concentration des réactifs ([\(Cu^{2+}\)]), comment évolue la f.é.m. de la pile ?
4. Quelle est la valeur de 'n' (nombre d'électrons échangés) pour la réaction globale de la pile Daniell ?
5. Dans quelles conditions la f.é.m. d'une pile (\(E_{\text{pile}}\)) est-elle égale à sa f.é.m. standard (\(E^0_{\text{pile}}\)) ?
- Anode
- L'électrode où se produit la réaction d'oxydation (perte d'électrons). Dans une pile, c'est la borne négative.
- Cathode
- L'électrode où se produit la réaction de réduction (gain d'électrons). Dans une pile, c'est la borne positive.
- Pont Salin
- Un dispositif contenant une solution d'électrolyte inerte qui relie les deux demi-piles, fermant le circuit électrique en permettant la migration des ions pour maintenir la neutralité de chaque solution.
- Force Électromotrice (f.é.m.)
- La différence de potentiel électrique maximale entre les deux électrodes d'une pile, mesurée en Volts (V). Elle représente la "force" qui pousse les électrons dans le circuit.
- Relation de Nernst
- Une équation qui relie la force électromotrice d'une pile aux concentrations de ses réactifs et produits, ainsi qu'à la température.
D’autres exercices de thermodynamique chimique:
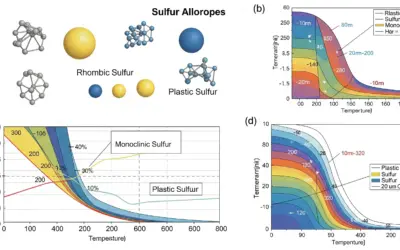
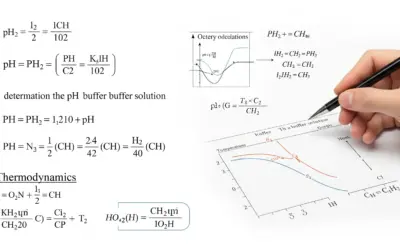
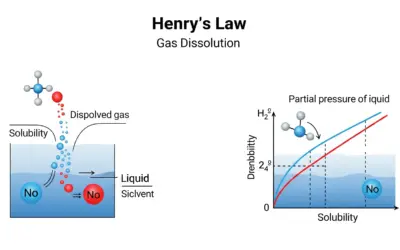
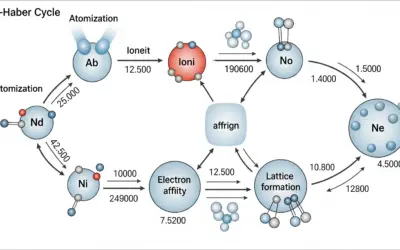

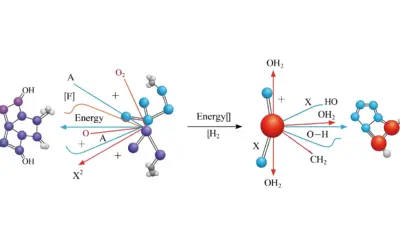
0 commentaires